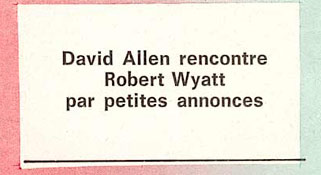| |
|
|
 A
Londres des jeunes freaks en fleurs - Actuel - N° 51 -
février 1975 A
Londres des jeunes freaks en fleurs - Actuel - N° 51 -
février 1975
A LONDRES DES
JEUNES FREAKS
EN FLEURS
|

|
Tandis que Virgin donne l'exemple,
Mike Ratledge cultive l'émotion, Robert Wyatt passe
ses journées à réfléchir et
Bill Bruford garde son calme.
"Pour avoir du succès en Angleterre, il
faut être soit complètement imbécile,
soit donner l'impression que vous venez de vous lever
de votre siège pour monter sur scène et
vous proclamer un amateur. La seule chose qu'il ne faut
surtout pas faire, c'est bien jouer. Ecrivez des paroles
qui ont une "signification profonde, ou, mieux, aucun
sens; volez quelques riffs à Terry Riley ; pour
les solos, pastichez le jazz d'avant-garde d'il y a vingt-cinq
ans, celui que tous les musiciens de jazz ont complètement
oublié. Assurez-vous de jouer faux, évitez
à tout prix les rythmes intéressants, et
vous avez un de ces groupes "modernes" - ou
un disque Virgin."
Boum. J'espérais trouver un défenseur de
cette scène anglaise turbulente et excentrique,
celle des Eno, des Robert Wyatt, des Kevin Ayers, la postérité
de Soft Machine et les groupes des disques Virgin. Je
me suis trompé de porte. John Marshall observe
mon désarroi d'un oeil amusé, les autres
membres de Soft Machine opinent du bonnet... "Je
sais, il y a des dizaines de groupes anglais aujourd'hui
qui copient l'ancien Soft Machine. Tous sauf nous. C'est
un luxe que nous sommes seuls à pouvoir nous permettre."
" A quoi ressemble le nouveau Soft Machine, qui vient
de commencer par un concert à la fac d'Assas une
petite tournée française ? Rien de très
différent de ce à quoi il nous a habitués
depuis deux ou trois ans. Une introduction à deux
pianos électriques, façon Terry Riley, des
rythmes rock lourdement efficaces, quelques fracas électroniques,
beaucoup de solos et d'improvisation. Le groupe a engagé
un guitariste, visage de rongeur du musicien anglais typique,
il a fait ses classes dans des groupes de rock anglais,
loin du jazz et des musiques de recherche. Mike Ratledge
passe son temps chez lui à démonter et remonter
son synthétiseur. Il est le seul dans 1e groupe
à s'intéresser vaguement à la musique
contemporaine, et encore, il n'en écoute jamais.
Les autres ? "La musique noire, Stevie Wonder. Le
rock de la bonne époque, Hendrix, Cream, les Who."
Avant de jouer, on se soûle à la bière,
la sono est puissante, tout le monde se balance en rythme
et Ratledge, le visage imperturbable, s'extériorise
en de drôles de sursauts des coudes et des épaules.
"On ne joue pas de la musique tarabiscotée.
On fait ce qui vient naturellement: tout dans l'émotion.
Contrairement à notre réputation, nous ne
sommes pas des intellectuels. Nous sommes seulement intelligents."
Le guitariste ricane: "Pas du tout, moi, je ne suis
même pas intelligent!"
Le Soft Machine a bien changé, mais la scène
anglaise qu'il a contribué à créer
n'est pas morte pour autant. Souvenez-vous, il y a huit
ans, l'acide bouillonnait dans les cervelles, une génération
de musiciens, Pink Floyd et Soft Machine en tête,
accommodaient le rock à des sauces bien étranges.
Quatre ans plus tard, Soft Machine agissait comme catalyseur
de ce vaste brassage entre musiciens de rock, de jazz
et de musique contemporaine, dans des projets grandioses
comme le Centipède, cet orchestre de cent musiciens
venus de tous les horizons.
En 1975, les tentatives originales fusent
de plus belle. Au centre du mouvement on trouve les disques
Virgin, d'anciens freaks devenus des capitalistes rudement
intelligents qui ont réussi à vendre cette
musique réputée invendable (et dont Actuel
raconte l'histoire dans son n° 37. en vente au journal,
4 F, merci). Grâce à eux les groupes grouillent,
les disques pleuvent, les vieilles têtes reparaissent
et les nouvelles se lancent: des noms familiers, Gong,
Robert Wyatt, d'autres inconnus ou presque il y a un an,
Mike Oldfield, David Bedford, Hatfield and the North,
Egg, Coxhill/Miller, Kevin Coyne, White Noise, ou Henry
Cow, dont le guitariste Fred Frith vient de sortir un
étonnant album de guitare solo digne de Stockhausen.
Virgin donne l'exemple, les grandes marques commencent
à suivre. Island a engagé pour choisir ses
groupes Richard Williams, ancien critique au Melody
Maker où il défendait depuis longtemps
les musiques d'avant-garde. Island produisait déjà
King Crimson et Roxy Music, elle a signé Eno, Kevin
Ayers, Nico, John Cale.
Robert Wyatt habite, comme la
plupart des musiciens anglais, un pavillon dans la banlieue
de Londres, grandes pièces peintes de couleurs
vives et larges baies vitrées. Après le
joyeux capharnaüm de la cuisine, on passe le dépouillement
de la salle de musique - un piano à queue, un petit
orgue électrique, un magnétophone, et les
textes de quelques chansons soigneusement tapés
à la machine. Il y a une cheminée dans le
living room, tapissée de cartes de voeux, des piles
de disques sur le sol et un mauvais électrophone.
"En ce moment, j'écoute surtout du jazz, Thelonius
Monk, Charlie Parker, Charlie Mingus".
Que fais-tu de tes journées ? "Je réfléchis.
J'ai beaucoup d'idées, mais je les rejette toutes
le matin suivant. Résultat : je suis en retard
sur mon planning. Virgin aimerait que je sorte deux albums
par an. Remarque, je pourrais facilement en faire dix,
mais ils se répéteraient. J'aime que chaque
album ait une bonne raison d'exister, et ne ressemble
pas à la seconde partie du précédent.
Alors je travaille dur, mais je progresse lentement."
Ce souci de ne pas se répéter, Wyatt l'applique
jusque dans ses interviews. "Quand j'ai lu deux fois
une de mes idées dans un journal, j'essaie de trouver
autre chose." On tient là la clé du
personnage : un esprit agile, en éveil, sans cesse
occupé à faire reculer ses propres limites.
Wyatt n'a pas attendu l'accident qui lui a paralysé
les jambes pour tripoter les claviers et prospecter les
mille usages insolites ou saugrenus de la voix humaine.
Encore batteur dû Soft Machine, il appliquait quelques-unes de ses idées dans un étonnant album
solo, "The End of an Ear". La brève existence
de Matching Mole continue la démarche, un peu noyée
dans les exercices de style de ce jazz-rock électrique
qu'on vient de découvrir. Enfin, l'album "Rock
bottom" se révèle si enthousiasmant
qu'on se surprend parfois à considérer son
accident comme une bonne aubaine.
"J'aurais aimé travailler avec Matching Mole
de la façon dont je travaille à présent
: une relation occasionnelle, détendue, qui ne
Vous impose pas d'avoir à vous adapter constamment
aux autres. Un groupe ressemble souvent à une prison.
Je ne me vois plus en train de jouer en concert avec un
groupe. Je travaille plutôt comme un peintre, petite
touche par petite touche. Est-ce que tu imagines David
Hockney au Palais des Sports ? Il arrive avec sa toile
sous les applaudissements de la foule et il peint pendant
deux heures tandis que les gens crient "oh le beau
bleu, ah! quel joli rouge ?" Non, vraiment, on se
concentre mieux dans son atelier. D'ailleurs, je ne vais
jamais aux concerts de rock. Je n'appartiens plus à
ce monde."
|

|
Quand on lui parle de la scène
anglaise, Wyatt évoque l'expérience historique
du Centipède de Keith Tipett. "Le Centipède
a été l'équivalent anglais du Jazz
Composers Orchestra de Mike Mantler et Carla Bley : plus
un événement social qu'une démarche
musicale. Pour des raisons pratiques, les musiciens trouvent
peu d'occasions de se rencontrer. Quand on arrive à
faire jouer un grand nombre ensemble, ça crée
des étincelles. L'impact reste énorme, même
si tous les participants sont revenus aujourd'hui à
leur élément familier. Pendant les premières
répétitions, on a vu arriver les musiciens pop chevelus,
les musiciens classiques aux cheveux courts, les musiciens
de jazz entre les deux. L'année suivante, les classiques
se défonçaient, laissaient pousser leurs cheveux et commençaient
à improviser sur leur violoncelle pendant que les musiciens
pop se rasaient le crâne et entraient en religion..."
Tu écoutes de la musique contemporaine ? "On en écoutait
dans ma famille, j'ai grandi avec. En conséquence, elle
ne me paraît pas si excitante. La véritable aventure a
consisté pour moi à découvrir la musique populaire. Ma
première idée musicale: et si on collait un morceau de
Stockhausen sur une rythmique de James Brown ? Depuis,
j'ai découvert tant de choses qui m'intéressent plus même
si, superficiellement, elles paraissent moins nouvelles
et moins dynamiques."
"J'adore le flamenco, qui doit certainement venir de la
musique arabe: j'y trouve un côté blues, noir, quelque
chose de complètement différent de tous les autres chants
méditerranéens, qui ont fini par donner l'opéra. Le chant
le plus extraordinaire que j'ai entendu, c'est celui de
l'Inde du Sud, le carnatique m'a beaucoup influencé."
"J'aime nettement mieux écouter la musique que la jouer.
Je ne ressens aucun plaisir physique à me servir d'un
instrument, au contraire de beaucoup de musiciens avec
qui je travaille. Je joue parce qu'il y a des choses que
j'ai envie d'entendre et qui n'existent sur aucun disque.
Mais je serais vraiment content si d'autres que moi s'en
chargeaient. Je me recaserais dans la critique musicale."
La musique de Wyatt dépasse de cent coudées les recherches
confuses de la plupart de ses compagnons. Elle est lyrique
et généreuse, ils tombent souvent dans la sécheresse et
l'abstraction. Elle déborde d'humour, trop d'entre eux
se prennent au sérieux. Elle évite tous les systèmes dans
lesquelles ils foncent tête baissée, l'indigestion de
synthétiseur, les compositions trop rigides, les tics
hérités du Soft Machine.
On trouve à prendre et à laisser dans cette scène anglaise.
A son passif, l'absence de swing, noyé dans les rythmes
composés. A force de sauter d'un rythme à l'autre et de
se refuser le répit d'une mélodie simple ou d'un tempo
confortable, on se prend les pieds dans d'inextricables
dentelles, toiles d'araignée musicales; bavardages instrumentaux
(et pan sur Egg et Hatfield and the North). Autre excès:
l'amateurisme inspiré, grand credo chez Eno et quelques
autres, ne donne pas toujours des résultats enthousiasmants,
les oeuvres d'Eno lui-même en fournissent un bon
exemple.
Nous avons cherché quelqu'un qui puisse apprécier
toutes les recherches avec distance et lucidité,
mais aussi sympathie. Nous avons trouvé David
Bedford, ancien pianiste du Whole World, le groupe
de Kevin Ayers, l'arrangeur des disques de Kevin et l'auteur
d'une version orchestrale des deux albums de Mike Oldfield,
qui doit bientôt sortir sur disque. Dans ce milieu
où tout le monde grappille un peu de musique contemporaine,
il est le seul compositeur d'avant-garde bon teint, avec
un diplôme de la Royal Academy of Music et un stage
à Venise auprès du compositeur Luigi Nono
("Le premier mois, il m'a fait écrire des
compositions pour une seule note.)
A son actif, une demi-douzaine de morceaux inclus dans
des albums de musique contemporaine, et "Star's End",
une composition de quarante minutes pour grand orchestre
et guitare électrique, enregistrée par Virgin.
Un bel édifice, dense, riche en rebondissements
et d'un éclectisme de bon aloi. Bedford s'y promène
des bruissements debussystes aux grandes nappes de Ligetti,
alterne les passages planants et les dissonances exaspérées,
et emprunte habilement à Mike Oldfield quelques
unes des recettes de ses deux best-sellers.
"Quand on m'a proposé de faire partie du groupe
Kevin Ayers, ça m'a amusé. Je trouvais ça
romantique, je ne me rendais pas compte exactement. En
fait, c'est du boulot, et du sérieux: faire six
heures de route, jouer une heure et se taper encore six
heures pour rentrer chez soi. Pour rien au monde je ne
jouerai à nouveau dans un groupe.
Bedford a une noble allure avec ses cheveux et sa barbe
bien taillés et prématurément gris.
Assis en tailleur, il bricole le planeur télécommandé
que Mike Oldfield lui a offert pour Noël. Aux murs,
des livres de science-fiction (" J'en possède
deux mille") et des télescopes. "L'autre
jour, s'extasie Wyatt, il m'a montré Saturne pour
de vrai, avec ses anneaux et tout. Je n'en revenais pas."
Sur le vieux piano droit, sérieusement désaccordé,
des partitions d'Elton John, "pour me délasser..."
Dans la pièce à côté, ses deux
filles regardent la télévision en couleurs.
Malgré son flirt avec le rock, Bedford reste un
compositeur au sens traditionnel du terme. "Il y
a autant de possibilités sonores dans un grand
orchestre qu'avec tous les synthétiseurs du monde.
Il reste encore beaucoup de musique sur partition à
écrire.
"J'ai fait récemment une émission de
radio avec Robert Fripp. Nous avons collé bout
à bout des morceaux de Henry Cow, du New Phonic
Arts et du Spontaneous Music Ensemble: du rock d'avant-garde,
de la musique contemporaine et du free jazz. Personne
n'a pu remarquer la différence...
"Ce n'est qu'une ressemblance superficielle. Je ne
vois pas de grandes réussites parmi tous les groupes
de rock expérimental, mais ils travaillent dans
la bonne direction, ils brisent les barrières,
ils poussent les gens à s'intéresser à
d'autres musiques, à Ravel ou à Stockhausen.
Ce qui leur manque pour créer des oeuvres durables
? Une technique suffisante pour développer un morceau
sur les vingt minutes que dure une face de disque, lui
donner une forme, une structure.
"Pour Star's End", la structure découlait
du thème, celui de l'entropie, une idée
que l'on retrouve beaucoup dans la science-fiction moderne,
Ballard ou Philip K. Dick. C'est l'idée de la décomposition,
des choses qui retournent au chaos et à l'inorganisé.
Je prends un accord ou un rythme, et les notes commencent
à dérailler l'une après l'autre.
J'accomplis aussi le mouvement inverse, car l'entropie
procède par cycles, l'univers meurt et renaît.
Le morceau finit très calmement, sur une note d'apaisement
ou de résignation."
Parmi tous les groupes du nouveau rock anglais, il en
est un qui les résume et les dépasse, sur
disque comme sur scène : Gong. Eh oui. Ce
bon vieux Gong, qui, à force de s'améliorer,
est devenu un des meilleurs groupes du monde. Or, coïncidence
admirable, ne doit-on pas reconnaître en Daevid
Allen, le grain de sable qui a déclenché
toute l'avalanche, au début des années soixante
?
Mike Ratledge expliquait dans une interview de 1972 :
"Daevid Allen est arrivé chez Robert avec
deux cent disques de jazz, qui ont aussitôt circulé
parmi nous. Je ne sais pas ce qui se serait passé
sans cela." et Robert Wyatt confirme : "Le Soft
Machine originel, c'était Daevid Allen : ses structures
de raga, ses chansons, ses conceptions rythmiques et sonores,
son goût pour les longues improvisations, et son
jeu de guitare dingue: c'était le seul guitariste
de son époque qui évitait les éternelles
resucées de blues. C'est la première personne
que j'ai rencontrée qui portait les cheveux longs
et se défonçait."
"Mais non, objectera Daevid. Les véritables
responsables, ce sont les Docteurs d'Octave, qui se servent
des humains inconscients pour réaliser le plan
cosmique. Depuis le début, ils ont manigancé
de drôles de hasards. Tenez, pour tout commencer,
cette petite annonce que Daevid passe dans le Times
pour trouver une chambre à louer. La mère
de Robert Wyatt y répond. Daevid débarque
avec ses disques et ses idées bizarres, et voilà.
Un autre exemple : en 1967, les services d'immigration
britanniques refusent à Daevid la permission de
rentrer en Angleterre avec le reste du Soft Machine. Je
ne pouvais pas rester avec les Soft : j'avais joué
un rôle d'initiateur, mon travail était fini.
Et je n'étais pas assez malin pour m'en rendre
compte. Le destin s'est chargé de me le faire comprendre."
En 1974, la tâche revient aux douaniers français,
qui, par une nuit de pleine lune, arrêtent le batteur
Laurie Allan avec un bout de H et lui interdisent de remettre
les pieds en France. Conséquence : un ami commun
leur présente Bill Bruford, que la brusque
disparition de King Crimson a réduit au chômage
depuis quelques semaines. Bruford, faut-il le préciser,
est une de ces bêtes de la batterie dont les membres
semblent spécialement taillés pour empoigner
des baguettes et enfoncer des pédales. Specimen
rare, il possède à la fois la versalité
acquise à l'école du jazz moderne et la
puissance dévastatrice des grands batteurs de rock.
Avec un nouveau musicien de cette trempe, Gong devient
le "supergroupe" du rock moderniste anglais.
Ceux qui l'ont vu pendant la seconde partie de sa tournée
française s'en souviendront longtemps. A la salle
Wagram par exemple : Tim Blake, entouré de trois
synthétiseurs, commence par tisser des voiles translucides,
un brouillard hallucinogène qui appelle l'esprit
vers les grandes dérives. Le groupe chante le mantra,
de plus en plus fort. "i a-o a-i ao, ai ao...",
les forces maléfiques se dissipent. D'un coup,
la section rythmique pilonne et la machine décolle
droit vers les étoiles. Un laser dessine d'hypnotisantes
spirales derrière la scène. Bruford envoie
des grands paquets d'énergie qui cinglent les solistes,
un grand vent gonfle les voiles de ce navire aérien
qui entraîne derrière lui deux mille spectateurs
pris de vertige. On ne redescendra pas pendant plus d'une
heure, et, comble de bonheur, la fin vous dépose
en douceur, la psalmodie "I am you and you are I"
se fond lentement dans le silence.
Et pourtant, assure Gong, ce n'était qu'un concert
très moyen. Steve Hillage a passé la soirée
à se battre contre ses pédales, et seule
la maréchaussée a permis à Tim de
rentrer dans la salle. Pendant le concert, Richard Branson,
le patron de Virgin, dissuadait un commissaire de police
d'intervenir en force, à la suite d'un malencontreux
coup de téléphone. A Actuel, on compatit
: on a bien connu ça pour le concert des groupes
allemands au T.O.P.
L'hôtel chinois en face de la salle Wagram sort
tout droit du "Lotus Bleu", comme son patron
chinois qui se tord les mains de désespoir devant
la cohue des individus hirsutes. Bill Bruford garde un
calme impérial au milieu de l'agitation et parle
d'une belle voix de basse, l'accent cultivé. Il
a la tâte bien ordonnée, un contraste absolu
avec "l'anarchie flottante" chère aux
vieux membres de Gong. "j'ai appris la batterie dans
un cours de jazz qui se tient tous les ans au Pays de
Galles. Il y avait Keith Tippett, Marc Charig, Nick Evans,
tous les meilleurs musiciens anglais. J'avais pour professeur
John Marshall, l'actuel batteur de Soft Machine. Je vivais
sous une tente, et on travaillait toute la journée,
par petits groupes, à essayer d'arranger collectivement
des morceaux."
Après à peine une demi-douzaine de concerts,
Bruford s'est fondu dans la musique sans un accroc. "J'ai
travaillé sur les disques, deux jours avant le
premier concert. Je n'avais rien entendu de Gong auparavant.
Pierre, l'ancien batteur, est imbattable, il a une frappe
quasiment parfaite : question d'attaque, il faut retirer
la baguette avant même qu'elle ne touche la peau".
"C'est le même principe que le karaté"
commente Didier Malherbe, dont le béret bleu
marine s'orne d'un superbe oeuf sur le plat en plastique.
Tout autour, il n'est question que de l'épineux
problème du différend entre Byg et Virgin
Records. "Je viens de voir le "Camembert"
vendu 60 F chez Lido Musique, c'est ridicule !".
Bruford parle chiffres d'un ton catégorique avec
Tim et Didier. "J'ai discuté avec Branson.
Gong continue à coûter beaucoup plus d'argent
qu'il n'en rapporte. Vous ne pouvez pas continuer comme
ça, c'est comme si vous passiez des vacances très
longues et très chères." - "Que
faire ?" - "Un disque d'or, c'est la seule solution.
Sinon, vous finirez en prison." - "Mais Virgin
ne va quand même pas nous traîner devant les
tribunaux ?" - "Oh, tout peut arriver..."
De la table voisine, Daevid interpelle : "Hey ! j'ai
une double-page de poèmes pour Actuel, je
les envoie dès qu'ils sont traduits en français."
Hey ! Daevid, on les attend toujours !
Jean-Pierre Lentin
|