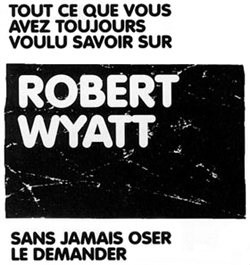| |
|
|
 Tout
ce que vous avez toujours voulu savoir sur Robert Wyatt
sans jamais oser le demander - Vibrations - N° 51 - mars
2003 Tout
ce que vous avez toujours voulu savoir sur Robert Wyatt
sans jamais oser le demander - Vibrations - N° 51 - mars
2003
|

|
"Parfois, je sors de ma tanière pour enregistrer
un disque. je me sens alors comme un étranger qui
visiterait un étrange pays: le pays des musiciens.
Pour être franc, je ne me suis jamais vraiment senti
à mon aise dans ce milieu-là."
Ainsi Robert Wyatt s'exprimait-il à la fin de l'été
1997, alors qu'il venait tout juste d'achever "Shleep",
son dernier album à ce jour. Ces quelques mots résument
parfaitement la mentalité de cet électron
libre, qui n'a jamais brigué un poste fixe ou une
position influente dans le grand organigramme de la musique
moderne.
Des aventures mouvementées en compagnie de Soft Machine
jusqu'aux fugues solitaires de "Rock Bottom" ou
de "Old Rottenhat", cet éternel flâneur
a su pousser son chemin vers des zones préservées,
où l'esprit de compétition et la dictature
des modes n'exerçaient pas leur emprise. Quatre décennies
d'activités plus ou moins soutenues, de pures songeries
et d'âpres combats, d'acrobaties pataphysiques et
de chansons toutes nues, d'illuminations soudaines et de
longues éclipses, n'ont pas réussi à
le transformer en vieux briscard. Aujourd'hui âgé
de 58 ans, Wyatt reste à nos yeux cet amateur de
génie invité par erreur chez les professionnels
de la profession, ce non-spécialiste entré
clandestinement au royaume des experts et des forts en thème.
Avec lui, l'adjectif dilettante, que le langage courant
leste souvent d'une inexplicable charge péjorative,
renvoie à une forme d'exigence poétique et
de sagesse rêveuse que les musiciens installés
ne pourront jamais tout à fait connaître.
|

|
Wyatt est le symbole le plus éclatant d'une certaine
excellence britannique qui, à l'écart de l'orthodoxie
pop-rock incarnée par les Beatles, les Stones et
consorts, a donné ses meilleurs fruits sous le climat
bouillonnant des années 60. Comme Derek Bailey, Kevin
Ayers, Fred Frith, Gavin Bryars, John Greaves ou Brian Eno,
il est l'enfant d'une époque où le paysage
culturel se transformait à vive allure et où
la partition du monde musical en obédiences et en
chapelles n'était pas franchement à l'ordre
du jour. Elevé au lait du be-bop, admirateur transi
de Thelonious Monk, Charlie Haden ou Don Cherry, Wyatt s'est
découvert peu à peu de solides inclinations
pour les harmonies pop, les rythmes caraïbes ou encore
les mélodies sucrées-salées d'un Burt
Bacharach. Sa grandeur est d'avoir su créer une musique
qui, sans l'illustrer littéralement, reflète
l'étendue de ses goûts.
Ceux qui appréhendent pour la première fois
son oeuvre ont souvent le sentiment de se heurter à
un étrange rébus. Comment décrypter
un langage qui, tout en partageant quelques points de tangence
avec le rock, le jazz, la pop ou les musiques expérimentales,
ne peut être réduit à une simple combinaison
d'influences? Que penser d'un musicien qui, pour tout arrangement,
sait volontiers se contenter d'un ruisselet d'orgue, d'un
piano aqueux et d'un nuage de cymbales? Que dire de cette
voix curieusement délavée, qui ne recourt
pas à la lourde signalétique émotionnelle
si chère aux chanteurs populaires? Où ranger
une oeuvre qui, à maints égards, se joue des
clôtures censées séparer les avant-gardes
(ou ce qu'il en reste) des musiques pour tous ? Par sa relation
au métier de musicien comme par ses propositions
esthétiques, Wyatt n'a au fond jamais été
en phase avec les canons de la musique occidentale. L'accident
qui, en 1973, l'a cloué à vie sur une chaise
roulante a naturellement renforcé ce décalage.
Peu après "Rock Bottom" (1974), l'Anglais
a fait une croix sur les performances live et a adopté
un rythme de travail nettement plus irrégulier qu'à
ses débuts. Ces choix-Ià, qui auraient pu
le confiner dans une marginalité de plus en plus
asphyxiante, l'ont imposé au fil des ans comme l'un
des créateurs les plus affranchis de ce temps. Wyatt
n'est pas un cas à part ni une anomalie. Il est l'un
de ces bienheureux inconscients qui, en toute simplicité,
ont choisi de vivre au centre de leur propre monde.
|

|
1969
Soft Machine
Volume Two
(PROBE)
Lorsqu'il enregistre ce disque, Soft Machine sort d'une
préhistoire plutôt chargée, agitée
et remarquée. Le groupe a déjà connu
une première mouture (comprenant notamment Daevid
Allen, futur Gong, et Kevin Ayers) et assuré deux
tournées américaines bien arrosées
en soutien de Jimi Hendrix. Il a aussi troussé un
premier album ("Volume One" en 1968) qui, avec
un sens plutôt réjouissant du désordre,
aura inventé une nouvelle façon de filer à
l'anglaise. Réduit à un trio (Hugh Hopper
à la basse, Mike Ratledge aux claviers et Wyatt au
chant et à la batterie), Soft Machine parvient sur
ce deuxième opus à unifier et densifier une
musique pourtant vouée à l'éparpillement
des idées et à l'éclatement des formes.
Trait d'union oblique entre délires de jamsession,
fulgurances pop et coq-à-l'âne pataphysiques
(le groupe a été décoré de l'Ordre
de la Grande Gidouille en 1967), ce patchwork gonflé
mais pas gonflant doit beaucoup à la verve contagieuse
de Wyatt qui co-signe la quasi-totalité des titres.
Ce dernier ne retrouvera une telle liberté de création
qu'après avoir quitté le groupe, en septembre
1971.
1970
Soft Machine
Third
(cbs)
S'il a laissé un souvenir impérissable dans
l'esprit de ses fans, Soft Machine est resté pour
Wyatt une expérience éprouvante, voire humiliante.
"J'ai été tourné en ridicule et
maltraité par les musiciens avec lesquels je travaillais ", dira-t-il encore trente ans après les faits.
Jusqu'à cet album, les membres du groupe avaient
su bâtir une identité commune autour d'une
chimie humaine et musicale pour le moins instable. "Third"
sera leur pomme de discorde: le fossé se creuse entre
Hopper et Ratledge, partisans d'une voie plus sérieuse
et instrumentale, et Wyatt, désireux d'aller de l'avant
sans se plier à une ligne esthétique prédéfinie.
En position de force, les deux premiers s'adjugent trois
des quatre longues suites que compte cet ambitieux double
album. Leurs montages sonores ne manquent pas de panache,
mais ils sont surclassés par l'unique contribution
de Wyatt, le terrassant "Moon in June": une incroyable
pièce gigogne longue de dix neuf minutes, dont chaque
mesure semble receler la promesse de dix autres morceaux.
Multi-instrumentiste jongleur doublé d'un chanteur
contorsionniste, Wyatt invente là un langage virtuose
qui ne cède jamais à la tentation du tour
de force. En musique, la générosité,
- tout comme la sincérité ou l'intégrité,
n'est pas un talent. Mais c'est une vertu qui, chez Wyatt,
souligne la nature de son génie: cet homme sait commuer
la plus invraisemblable bizarrerie en évidence, en
beauté modestement offerte. "Moon In June"
est un classique instantané qui, si le monde était
un peu moins sourd et frileux, serait aussi populaire que
"Let it Be" ou "(I Can't Get No) Satisfaction".
|

|
1972
Matching Mole
Matching Mole
(cas)
En nommant son nouveau groupe Matching Mole (transcription
phonétique du français "Machine Molle"),
Wyatt adresse un malicieux pied de nez aux deux petits caporaux
qui le brimèrent au sein de Soft Machine. Après
avoir papillonné de projets extérieurs en
collaborations (avec Centipede, Amazing Band ou Kevin Ayers),
l'Anglais se reconcentre sur son ouvrage en contrôlant
quasiment de A à Z ce disque à la fraîcheur
presque printanière concocté avec David Sinclair
(claviers), Phil Miller (guitare) et Billy MacCormick (basse).
Nettement plus facile d'accès que son premier essai
solo (le très expérimental "The End of
an Ear" sorti en 1970), "Matching Mole" réconcilie
les deux facettes d'un musicien qui ose à la fois
s'adonner aux plaisirs féroces de l'improvisation
"Part of the Dance") et s'affirmer comme un mélodiste
supérieur - voir la ritournelle sentimentale "O
Caroline" et ce sommet de non-sens pop qu'est "Signed
Curtain". Un deuxième disque plus collectif
et inégal suivra "Little Red Record", produit
par Robert Fripp) avant que Wyatt n'envisage de refondre
totalement le groupe. Un tragique coup du sort l'en empêchera:
le 1er juin 1973, au cours d'une fête particulièrement
alcoolisée, il chute du quatrième étage
d'un appartement londonien. Wyatt en réchappe miraculeusement,
mais il restera à jamais paraplégique.
|

|
1974
Robert Wyatt
Rock Bottom
(RYKODISC)
Les coulures d'orgue, les notes de piano qui tombent en
pluie, le flic-floc discret des percussions et la voix qui
glisse en sinuant "You look different every time"...
A chaque nouvelle écoute, les premières mesures
de "Sea Song" renforcent le mystère d'une
musique qui colonise la conscience de l'auditeur comme les
eaux montantes d'un fleuve prendraient possession d'une
terre - lentement et sûrement, par le bas. Après
en avoir dressé l'ébauche lors d'un séjour
à Venise en 1972, Wyatt a ruminé "Rock
Bottom" des mois durant sur son lit d'hôpital.
Pour autant, ce disque sans égal dans la production
musicale contemporaine n'est pas un obscur labyrinthe mental,
le chant intérieur d'un homme prisonnier de lui-même.
Il s'agit d'abord, selon les propres termes de son auteur,
d'un chant d'amour et de curiosité" adressé
à sa compagne Alfie qu'il vient tout juste d'épouser.
Surtout, "Rock Bottom" marque l'éclosion
définitive d'un nouveau Wyatt, comme allégé
par le drame qui lui a coûté l'usage de ses
jambes. Le musicien devient ici un plasticien qui, avec
trois tubes percés, deux pinceaux pelés et
une toile bon marché, brosse une épure qui
a la richesse d'une fresque. Tout ici est faussement monochrome,
des à-plats de claviers étalés par
couches successives jusqu'à ce chant blanc et cassé
qui, par de troublantes irisations, semble réfléchir
toutes les couleurs du spectre vocal. Souvent décrit
comme un abîme de mélancolie, ce disque est
avant tout un sommet de musicalité que les années
n'ont pas érodé. Si "Rock Bottom"
touche le fond, c'est d'abord le fond des choses, l'essence
même du chant, l'origine du geste musical. L'histoire
du rock considère généralement comme
cruciaux les disques qui savent synthétiser le passé
et ceux qui savent prédire le futur. "Rock Bottom"
n'appartient à aucune de ces deux catégories.
C'est une brèche dans l'espace-temps, un vertigineux
pas de côté, un univers parallèle dont
la face cachée se dérobe aujourd'hui encore
à l'analyse.
1982
Robert Wyatt
Nothing Can Stop Us
(RYKODISC)
Pourquoi sélectionner ici ce disque bizarrement foutu
et tout rapiécé? Pourquoi ne pas lui préférer
par exemple les sonorités fauves de "Ruth is
Stranger Than Richard" (1975), contrepoint bariolé
aux subtils dégradés de "Rock Bottom"?
Pourquoi ne pas privilégier les collaborations fructueuses
de Wyatt avec Michael Mantler ou Brian Eno? Parce que "Nothing
Can Stop Us" marque le retour faussement anecdotique
d'un homme qui, sans la grande bienveillance du patron de
Rough Trade Geoff Travis, aurait vraisemblablement disparu
de la circulation. Certes, le disque est quelque peu plombé
par un arrière-fond idéologique pas toujours
léger - Wyatt, qui a adhéré au Communist
Party trois ans plus tôt, n'y va pas avec le dos de
la faucille lorsqu'il chante " Staline Wasn't Stallin'
". Mais il y a heureusement plus que cela: composée
pour l'essentiel de reprises, cette compilation de singles
dispersés au début des années 80 est
le juste reflet d'une sensibilité musicale en forme
de puzzle, tout à la fois morcelée et cohérente.
Par le passé, Wyatt avait apporté la preuve
de son éclectisme éclairé en reprenant
"I'm a Believer" de Neil Diamond et "Song
for Che" de Charlie Haden... Ici, il passe avec une
élégance désarmante d'une vieille scie
cubaine à une chanson de Chic, d'une protest-song
chilienne à une cover dépouillée de
"Strange Fruit", éblouissante d'intelligence
musicale. Vingt ans ont passé depuis la sortie de
ce disque et son esthétique un peu glacée
a brillamment survécu au discours politique qu'elle
était censée soutenir. A la même époque,
Wyatt illumine de sa présence deux disques de toute
beauté: le single "Shipbuilding" écrit
par Elvis Costello et le très attachant EP de Ben
Watt, "Summer Into Winter" (1983).
|

|
1985
Robert Wyatt
Old Rottenhat
(RYKODISC)
"Je suis un vrai minimaliste, parce que je n'en
fais pas des masses. je connais des minimalistes qui se
prétendent minimalistes mais qui font des tonnes
de minimalisme! C'est de la triche. Moi, vraiment, je
ne fais pas grand-chose..." Cette profession de foi
pourrait être placée en exergue d'un disque
à priori ingrat, aux arrangements faméliques,
bien moins accueillant que ne le sera l'album "Dondestan"
(1991). Et pourtant: c'est vers ces plages arides que
nous aimons revenir. Remonté comme une pendule
contre l'Angleterre de Thatcher et les Etats-Unis de Reagan,
Wyatt s'est juré de réaliser un album que
les conservateurs de tous pays et de tous poils ne pourraient
pas écouter ni détourner à leur profit.
Sur ce plan, le pari est réussi, mais une fois
de plus c'est la valeur musicale du projet qui, plus que
sa connotation politique, emporte le morceau. Wyatt, qui
se décrira quelques années plus tard comme
un "Jimmy Sommerville sous Valium", psalmodie
ici comme un chanteur de flamenco qui aurait sifflé
une bouteille d'eau de Javel ou comme un muezzin qui aurait
trop fait la nouba: sa voix atteint son plus haut niveau
de rudesse et de blancheur. Autour, des claviers à
deux sous dessinent un décor désertique
et presque invariable où il fait bon se perdre.
C'est l'un des disques les plus radicaux de Wyatt. Hors
du silence lui-même, il n'existe sans doute pas
de musique plus gracieusement littérale que celle-ci.
(A noter que "Old Rottenhat", agrémenté
du maxi "Work In Progress" et des faces B de
"Shipbuilding", a également été
réédité en CD sous le titre "Mid-Eighties").
1997
Robert Wyatt
Shleep
(RYKODISC)
Contraction de "sheep" (mouton) et "sleep"
(sommeil), "Shleep" saisit Wyatt au sortir d'une
longue période de doute et de détresse morale.
Le moins que l'on puisse dire est que le réveil
est tonitruant: perché à un niveau d'inspiration
peu commun, Wyatt cloue le bec à tous ceux qui
le jugeaient moribond depuis "Rock Bottom".
Au générique de ce disque rêvé
figurent de vieux camarades (Phil Manzanera, Brian Eno,
Evan Parker ou la tromboniste Annie Whitehead) et quelques
nouveaux venus (dont l'inattendu Paul Weller): une sorte
de All-Star Band où les talents individuels ont
pour une fois le bon goût de s'additionner au lieu
de s'annuler. Souvent présenté comme un
animal plutôt solitaire, Wyatt démontre ici
qu'il peut être un hôte d'un grand raffinement,
qui sait combiner les instruments et les sensibilités
de chacun comme d'autres savent marier les différentes
couleurs de leur palette. A la fois mieux produit et plus
audacieux que ses prédécesseurs, "Shleep"
voit Wyatt chasser sur les terres de Brian Wilson ("Heaps
of Sheeps"), empiéter sur les plates-bandes
de Bob Dylan ("Blues in Bob Minor"), dérouler
une nursery rhyme surréaliste ("The Duchess")
ou livrer une confession d'une pénétrante
simplicité ("Free Will and Testament").
Une brebis n'y retrouverait pas ses petits? Peut-être,
à ceci près que ce disque possède
la logique particulière de ceux qui savent témoigner
d'un sens aigu de l'absurdité. "Shleep"
est un chef-d'oeuvre foisonnant et limpide, un disque
d'une cruelle beauté à côté
duquel les trois quarts de la production musicale du moment
auront pris un méchant coup de vieux. Depuis, Wyatt
s'est de nouveau assoupi. Mais des murmures de plus en
plus insistants soutiennent qu'il pourrait sortir très
prochainement de sa retraite. Le "pays des musiciens"
serait bien inspiré de lui réserver le meilleur
des accueils.
Soup Songs: A Tribute To Robert Wyatt, groupe emmené
par la tromboniste Annie Whitehead, se produira au Festival
Banlieues Bleues près de Paris le 15 mars. www.banlieuesbleues.org
|