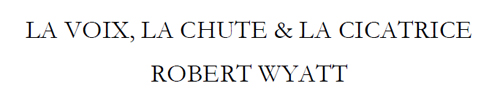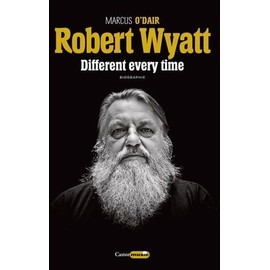| |
|
|
 La voix, la chute & la cicatrice, Robert Wyatt - Poezibao - 20 janvier 2022 La voix, la chute & la cicatrice, Robert Wyatt - Poezibao - 20 janvier 2022
I
Au-delà de ce que je vais pouvoir dire, je sais déjà que j’ignore en vérité
toujours tout des raisons, les vraies, les réelles qui me font, oui, en quelque
sorte me contraignent à le faire, parler de Robert Wyatt, ce musicien, ce
batteur, ce chanteur du groupe Soft Machine, puis de Matching Mole et
qui, débutée à la fin des années soixante, poursuit sa carrière désormais
seul. Robert Wyatt est à lui seul une de ces fulgurances musicales qui vous
a traversé, transpercé même, mais que vous ne comprenez pas plus que
cela. Car la musique que j’écoute depuis maintenant des décennies, à partir
de mes dix-sept ans – l’adolescence , elle, ne connut, mais passionnément
et avec érudition je crois, que la musique Pop, ainsi qu’on la nommait à
l’époque – a construit un espace intérieur, celui de la représentation et de
son cadre, celui des différentes tonalités de l’existence qui constituent jusqu’à aujourd’hui les repères qui me permettent du moins de croire
pouvoir m’appuyer sur quelques certitudes, celle des œuvres, en suivant
les indications des grands musiciens qui sont aussi, on l’oublie presque
toujours et partout, de très grands penseurs. Sans ces œuvres, Nietzsche y
insistait, la vie et l’existence ne vaudraient guère la peine et nous n’aurions
en vérité d’autre activité que celle de plaquer notre nez sur la surface des
choses, comme sur une vitre.
* * *
 Robert Wyatt en 2006 - Photo Wikipédia
Robert Wyatt en 2006 - Photo Wikipédia
|
Certes, mais plus exactement, qu’est-ce que la musique nous fait, au sens
propre, physique et non seulement spirituel du terme ? La question est en
effet décisive et elle exige quelques précisions. Et je me suis rendu compte
avec le temps que Robert Wyatt s’impose comme apportant l’une d’elle,
envers et contre tout, contre les habitudes prises, mais aussi parallèlement
en tout cas à toutes les voies de pensée et d’existence empruntées avec
Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Bruckner, Mahler,
Berg, Scriabine, Webern pour en rester aux classiques. Robert Wyatt a
donc touché quelque chose en moi, Robert Wyatt m’a fait quelque chose.
(Tout comme, à peine plus tard, avec fracas, ce fut un choc comparable à
la découverte d’un nouveau continent, ce fut une autre blessure, une
coupure, décisive celle-là, mais ça n’est pas ici le sujet, même si les choses
ne sont pas, on le comprend, sans rapport : l’écoute de la Grande Fugue de
Beethoven, la plupart du temps rattachée, comme son final, au quatuor à
cordes op. 130, le XIII°).
C’est alors bien davantage qu’une simple trace, c’est comme une cicatrice,
quelque chose qui a eu lieu et qui est toujours présent, pas seulement un
souvenir par conséquent. Toujours est-il que la cicatrice serait en effet la
plus belle image qui soit, parfois aussi la plus douloureuse de ce qu’est un événement. On emporte avec soi ce qui a marqué, et ce qui a marqué dans
ce qui était marquant, ce qui suppose une appropriation subjective, une
façon d’être modelé et formé par cette entaille en nous, alors que nous
n’étions rien, parce que jusque-là notre conformation ne tenait qu’à
l’hérédité, à une sorte de champ impersonnel qui forme notre fond. Or, il
n’y a de subjectivité réelle que heurtée, modifiée, détournée, blessée. C’est,
outre la difficulté de survivre qui est le propre des petits d’homme, ces êtres qui doivent composer avec leur immaturité, qui dépendent et ne
reposent que sur les autres et donc sur ce qu’ils ne sont pas eux-mêmes,
encore un autre défi que de s’enrouler ou non dans ce qui arrive jusqu’à y
lire l’existence qui sera la sienne, non plus par nécessité, mais par
reconnaissance. Très certainement, le nom de Robert Wyatt comme sa
musique, qui aura accompagné jusque dans de nombreuses et longues
périodes de ce qui ressemble à de l’oubli l’existence, recouvre, comme une
sorte de fétichisme psychique, bien d’autres personnages, et, j’en suis tout
autant persuadé, un peu toutes les musiques qui furent les miennes et celles
aussi, je l’espère, qui me restent encore à connaître et peut-être à traverser.
Parmi ces personnages, il y a Coltrane, Robert Wyatt était d’ailleurs lui-
même un inconditionnel de sa musique au point que ses propres mélodies
recouvrent (je n’ai pas trouvé trace d’une écoute admirative d’Eric Dolphy,
mais je ne puis m’empêcher de songer à lui en cet instant) et même
doublent ses solos, Schumann à l’évidence pour cette folie, pour la
constante tonalité de chute que dégage sa musique, Schubert aussi pour
l’errance et la solitude, Beethoven surtout pour son handicap, tout ce qui
de lui apparaissait comme inaudible, et tant et tant d’autres ...
Dans ce nom qui a la forme d’une question, l’interrogation est portée par
une voix, qui s’adresse d’abord à elle-même, qui se cherche comme on dit.
La voix de Robert Wyatt est en effet une question. Et c’est cette question
que j’ai à mon tour entendue et qui m’a arrêtée. On peut donner une image
de cela, certes seulement une image, mais vraiment une image : celle d’une
voix devenue intemporelle, que je ne puis dater ni référer à un moment de
l’existence, une voix qui se superpose à la mienne, ou bien l’inverse, en
tout cas l’impression, le marquage, la cicatrice par conséquent, d’un petit
garçon qui explore, et pas seulement dans ses rêves et ses cauchemars, les
parois d’une grotte, ou bien d’un caveau, ou encore de quelque boyau,
l’image donc se révélant, revenant d’on ne sait d’où et se précisant peu à
peu, de ce petit garçon qui gratte leurs surfaces comme pour y chercher
quelque chose, à vrai dire d’abord dans l’espoir qu’elles s’ouvrent et
laissent passer un peu de lumière.
À y revenir et y réfléchir davantage, ce qui dans cette disposition se
présente au premier plan de cette pensée, et pas seulement de la mémoire,
c’est cette insistance : pourquoi Robert Wyatt ? À cause de sa voix si
particulière, de quelques passages musicaux de l’album Third de Soft
Machine, Moon in june surtout, à cause de l’originalité incroyable de l’album Rock Bottom, que j’avais pourtant presque oublié pendant des décennies, en
somme de toutes ces présences, ces oublis, ces présences-oublis, ces
cicatrices ? Il s’avère que c’est bien la voix qui recouvre, en tous les sens
du terme, ces dimensions, qui les reprend, les dispose à nouveau, et cela
au-delà et par-delà la certitude que ces albums de Robert Wyatt ont
pourtant bien vieilli et qu’ils ne sont pas loin de n’être plus que des
documents d’époque, plus rien ne reflétant la nôtre. Mais il reste la voix,
cette voix…
On dit qu’elle chante faux, que c’est faux, insupportablement faux… On
comprend, mais c’est précisément tellement faux. Robert Wyatt tombe en
enfance, ce qui n’est pas la même chose que retomber en enfance.
Retomber est précisément le propre des hommes, des névrosés, de nous
tous, par infantilisme, si moche, si désastreux. On le voit dans la colère,
plus que jamais aujourd’hui, la dernière fois ce fut dans le nazisme, la rage,
l’immaturité. Tout à l’inverse, tomber en enfance appartient à l’avenir, c’est
rouvrir le langage, l’existence, c’est comme dit Deleuze, « se refaire une
naissance ». Au fond, c’est ce que font tous les grands musiciens et écrivains.
Cette enfance-là, devant, en avant, est elle-même un « monde » vers lequel
toutefois peu se dirigent. Il y faut du courage. Baudelaire : « l’artiste est une
enfant ». Cela sonne comme un impératif ou une condition plutôt que
comme un constat.
Si donc Robert Wyatt chante « faux », cette fausseté est en vérité la justesse
de l’enfance, sa façon à elle de gambader, de sautiller à cloche-pied dans la
nature. « Faux » est un mot d’adulte. « Faux » n’est pas un terme qui
appartient à la musique, sauf à la « musique », celle qui se fait, non celle qui
est expression et émotion. A-t-on jamais entendu une émotion « fausse » ?
(Et si elle l’est, si c’est manifeste, ça n’est plus de l’émotion). L’art de
Robert Wyatt, toute proportion gardée mais comme toute grande œuvre,
est à peine de « l’art ». Ce chant de l’enfance, cette voix trouvée, ne peut
guère être référée à la trouvaille du chanteur en herbe qui d’abord l’avait
cherchée et qui va se réjouir d’avoir mis au jour une voix d’artiste, celle
qu’on attend de lui. Car cette voix ne relève aucunement de l’art et du reste
ne tient pas à y correspondre. C’est en revanche une voix de poète si un
poète est celui qui parle du monde sans être conditionné dans son langage
par la reconnaissance du monde (cette voix n’attend pas d’être jugée, elle
est indifférente à cet égard). Enfin, on comprend qu’elle se moque de la
virtuosité et de la démonstrativité. En revanche, Robert Wyatt a percé en
amont, pour l’aval qui en est la parution et l’expression, un chemin vers
l’autre monde, non pas l’au-delà, mais celui qui ressemble à la pièce d’à
côté qu’on ne connaissait pas. Or le monde est, cela le définit, ce qui ignore
les pièces d’à côté dans lesquelles vivent les enfants.
Robert Wyatt cultiva l’abstraction à l’égard du monde, il fut, dans tous les
sens et pas seulement en raison de son handicap réel résultant de sa
défenestration, paralysé au monde. Le poème chanté s’est dégagé lors de la
chute dans le vide. Ce vide fut l’ouverture même du chemin vers ce poème
qu’on entend très bien décrit dans Rock Bottom, ce « fond touché » qui fut
en vérité l’espace nouveau d’une percée. Un vide qui ouvre ! Cela
contrevient à toutes les philosophies…
Toutefois, il ne s’agissait pas pour Robert Wyatt, c’est décidément certain,
de faire poème d’un accident. L’accident appartient au passé, à la vie
d’avant et à son agitation. À présent, et dans ce temps qui s’est ouvert,
Robert Wyatt est immobile, une sorte de Zénon de l’éternité, l’éternel
chanteur en position rythmique de batteur qui bat la mesure de sa pensée.
C’est elle que nous entendons, en poème, dans Rock Bottom.
Reprenons : Robert Wyatt, c’est donc d’abord un nom qui surprend et qui
pose, à même sa résonance à l’oreille, une interrogation : why ? Wyatt ? Why
Wyatt ? C’est ainsi que je l’ai entendu la première fois, je me souviens
étonnamment bien, mais on sait à quel point les jeunes gens rêvent sur les
mots et les noms, comment les noms propres leur apparaissent à cet égard
comme les communs, et, dans l’ignorance de leur signification, la pensée
se laisse aller vers eux et en eux comme si elle était attirée par les Sirènes.
Ce qui avait soutenu cette rêverie qui prenait le pas sur tout le reste, en
particulier le vide scolaire et le désastre familial, c’est que j’avais eu
connaissance, de façon très improbable, au fond d’une province, à l’âge
d’à peine quinze ans, du premier album de Soft Machine. Et je crois bien
qu’au-delà de quelques images alors fournies par cette encyclopédie
qu’était alors le périodique Rock and Folk, j’ignorais tout des visages et des
allures des musiciens. Mais gloire à Rock and Folk ! C’est avec lui que j’ai
appris à lire, que je me suis instruit pour devenir, je crois bien, à présent
que j’ai presque tout oublié, une encyclopédie vivante de la musique pop
de ces années-là, j’étais en effet incollable et je ne comprenais pas pourquoi
les autres n’avaient pas les mêmes connaissances que je désirais, pour sortir
de la solitude, à tout prix partager. Enfin, c’est dans ce journal que j’ai pris
contact avec la musique, oui. Il n’y a ni bonne ni mauvaise entrée. On entre
ou on n’entre pas, et toute entrée sincère, totale, est, c’est vrai,
abandonnée, érotique au sens que donne Bataille à « l’approbation de la vie
jusque dans la mort ». C’était vital, qu’on y songe sérieusement.
Souligner « why » dans Wyatt, c’est aussi se rappeler, je ne l’ai pourtant
deviné et ensuite appris que par la suite, le rapport très étroit que Robert
Wyatt entretenait avec la pataphysique. Il fréquentait les livres d’Alfred
Jarry. Soft Machine II est un album de pataphysique (par ailleurs, on
s’arrêtera sur la pochette créée par Byron Goto qui fut l’associé de Willem
de Kooning, image dont l’expressionnisme le dispute au délire
psychédélique). Le groupe y est même présenté comme « l’orchestre
officiel du Collège de “pataphysique”. Écoutons seulement le chant des
lettres de l’alphabet, dans l’ordre, puis à l’envers, en souvenir des repas
retournés souhaités par Jarry, en remontant du Brandy à la soupe !
On manquerait l’essentiel si on estimait que ces attitudes, pensées et
manifestations pataphysiques ne seraient qu’une pose. D’une part, la
pataphysique est bien une pensée, celle des contradictions qui, toutefois,
se soustrait aux principes énoncés une fois pour toutes par Aristote dans
sa Métaphysique, à savoir, pour l’essentiel, le principe d’identité, de tiers-exclu et de (non)-contradiction. L’essentiel tient en effet à l’exclusion de
ce qui touche à l’identité, une chose ne pouvant être en même temps et
sous le même rapport, écrit Aristote, différente d’elle-même… Plus
exactement : « Il est impossible qu'un même attribut appartienne et n'appartienne
pas en même temps et sous le même rapport à une même chose ». Or, c’est là manquer
une pensée de l’événement, ce que la pataphysique appelle une théorie des
exceptions. Ainsi, l’accident que subit Robert Wyatt et qui le paralysera
sera aussi, aussitôt, en même temps, parce que l’accident contenait un
événement, la porte d’ouverture d’une autre existence. En ce sens, la
cicatrice est et n’est plus, mais encore et toujours, aussi également, etc. Si
la pataphysique est, selon la formule célèbre, la science « qui étudie les lois
qui régissent les exceptions », elle est également celle qui traite des « solutions
imaginaires ». Cette « science » trouve son champ d’expérience dans ce
qu’on appelle « le monde des « enfants » … Cette « science » est ce qui nous
reste, parce qu’elle en est si l’on veut la reconstruction, de ce monde. L’attitude existentielle de Robert Wyatt, instruite par la pataphysique, se
laisse résumer ainsi : « Sur le long terme, c’est la seule façon que j’ai de considérer la
vie. Je la considère comme une blague. C’est au-delà de la tragédie ». Robert Wyatt
renvoie la pataphysique à son sérieux, lisons bien ce qu’il entend par
« blague », car le sérieux habituel ne l’est guère, recouvert qu’il est par le
voile de la blague de la non-contradiction qui ne correspond pas au réel,
c’est-à-dire non pas, en l’occurrence, à ce qu’on se représente dans et par
une chute, mais à ce qui agit, à savoir l’événement qui ouvre l’existence et
dont la cicatrice sera la marque sinon intemporelle du moins transtemporelle.
La pataphysique, on l’a dit, est au centre de Soft Machine II. De fait, il n’y a
qu’à consulter les titres : Pataphysical Introduction I & II, Dada was here…
Mais on n’oubliera pas qu’elle se tient d’abord au cœur du langage, de ce
qui est chanté, du poème, et même dans le jeu de batterie, dans les rythmes
impairs de battements par mesure, dans leur asymétrie ou leur irrésolution,
leur contradiction pourrait-on ajouter, comme l’existence elle-même,
comme le réel … En se tenant loin de la réalité (entendons les apparences
forment la représentation commune, celle par exemple qui nous montre
le soleil tourner autour de la terre), la pataphysique montre qu’elle est la
science du réel. Culturellement cette fois, Robert Wyatt, avec Soft
Machine, n’oublie pas Schoenberg dans Thank you Pierrot lunaire et Frank
Zappa et ses Mothers of Inventions.
II
Batteur du groupe de pop, de jazz, on ne sait pas trop, Soft Machine, puis
d’un autre, Matching Mole, par la suite d’une carrière en solo qui s’étend jusqu’à aujourd’hui, joueur occasionnel et pour le moins original de
claviers aussi, on le sait moins, chanteur surtout, surtout chanteur, mais à
peine chanteur au sens que recouvre habituellement ce mot. On ne parlera
donc presque que de cela, ne pouvant le faire d’autre chose, puisque c’est
cette voix de fausset, d’enfant, qui nous aimante. Une voix qui chante faux
et puis non, qui ne chante ni faux ni juste parce que ce n’est pas ce qu’on
attend d’une voix. On attend plus certainement qu’elle exprime quelque
chose d’exact, de pénétrant et d’enthousiasmant comme celle qui porte les
mots d’une maman, ou de la personne qui témoigne heureusement de son
amour.
La voix de Robert Wyatt est presque de tête, très haut perchée, immature
dirait-on, pas même une voix d’enfant, mais une voix enfantine, parfois
très féminine même. Elle est à la fois régressive et utopique, celle qu’on
imagine à propos d’un monde constitué uniquement, enfin, ou bien
seulement d’enfants ou bien d’hommes-enfants. (Dans Soft Machine I, le
début de Hope for Happiness est presque un blues heureux !). Ce fut cette
voix qui devint inoubliable puisqu’elle se fait toujours et encore entendre,
malgré toutes ses imperfections, et elle n’est sans doute même que cela, à
travers les « grandes musiques » que j’écoute désormais.
Incontestablement, soit elle résonne en écho à une conformation
psychique personnelle, ce qui n’est pas très intéressant puisqu’on pourrait
faire dans ce cas état de toutes les histoires individuelles, au même niveau
et de la même manière, soit elle énonce une vérité dans l’événement même,
au moyen de son insistance et de la mémoire fidèle qu’il a suscitée.
De la période d’adolescence, autant que je puisse m’y projeter, il me reste
ce lien, ce fil qui aura donc traversé toute l’existence. Et je m’interroge :
pourquoi lui ? Certes, il n’est pas tout à fait le seul, ou bien il s’est emmêlé
avec d’autres qui ont suivi au moyen d’une logique qui m’échappe, mais
j’ai cessé d’écouter la musique Pop lorsque sa diffusion, sa pénétration
médiatique lui ont assurément fait subir des infléchissements, et plus
certainement encore un véritable appauvrissement musical – on est tout de
même passé, pour faire référence à mon panthéon personnel, de Jimi
Hendrix, Keith Emerson, King Krimson, Frank Zappa, le premier Pink
Floyd et le premier Chicago, Cream, Blindfaith, Grateful Dead et bien sûr
quelques autres dont les qualités artistiques furent tout bonnement
extraordinaires et auxquelles l’histoire n’a pas jusqu’à aujourd’hui rendu
justice, aux « cultures contemporaines », industrielles, décadentes à tous
égards et douteuses, symbolisées par Michael Jackson et désormais
mondialisées dans les psalmodies meta-religieuses du rap qui outre qu’elles
nourrissent une clientèle aliénée et régressive font la promotion de la seule
et unique valeur, celle de l’argent dans un capitalisme envoûté et
s’écroulant dans son propre vide, et dont la seule pensée se laisse résumer
dans un doigt d’honneur.
Dans le partage des voix, il en existe certaines, très rares, qui sont si
singulières qu’elles le perturbent, et en réalité le redistribuent. Pourtant, au
regard de ce qu’on vient de dire d’elle, qui est esthétiquement peu
valorisant, on peut effectivement s’interroger sur les raisons qui motivent
chez Robert Wyatt le chant et même comment il a pu se faire que ses
compagnons de Soft Machine aient pu le laisser aller au chant au lieu de
se concentrer sur le jeu de batterie dans lequel, autant qu’on puisse en juger
par les albums du groupe, il excellait.
L’association fut faite assez vite et forme un des fils de la transition dont
j’ai fait état un peu plus haut : Robert Wyatt chantonne comme au même
moment Glenn Gould le fait encore ! C’est que le chantonnement est bien
une sorte d’invocation, c’est la modalité musicale du regard vers le haut,
c’est ce vers quoi la musique tend avec toutes ses forces. Et même, il figure,
disons esquisse ce que la musique devrait rejoindre. C’est pourquoi, sous
cet angle, rien n’est jamais aussi exact qu’un chantonnement, car il touche
au dictamen, à ce qui cherche à se dire dans la modalité impérative qui est
la sienne. D’où provient-il si ce n’est d’avant le sujet constitué. Il est la voix
avant qu’elle n’exprime son désir, elle forme sa raison si l’on veut, sa
tension et la pulsion qui lui a donné à la fois sa consistance et son grain.
Il n’empêche, pour qui écoute et surtout pour ceux à qui on la fait écouter
et qui en retour vous regardent d’un air étonné et interloqué, se posant
sans doute une question sur vos capacités de jugement esthétique, alors
qu’il ne s’agit absolument pas de cela, cette voix déraille ! Elle provient en
même temps de si loin comme gravée il y a longtemps et portée par un
vieux disque. Le climat qu’elle installe, et c’est étonnant dès lors qu’on
accepte, ne serait-ce qu’un instant, de se laisser guider par elle, est celui du
rêve, voire d’une sortie des limbes. Tout en elle est inabouti et immature.
Elle est, si l’on peut dire, l’enfance d’avant l’enfance, elle contient une
expression d’avant même l’absence de langage qui fait l’infans. Comment ?
Parce que l’accès au langage est lui-même déjoué par le ton, les tonalités
improbables. Si l’on préfère, elle est la voix restée dans la voix, qui y est
restée bloquée et qui parvient à s’en échapper malgré tout d’une certaine
manière, très fluette. C’est pourquoi on a risqué l’idée d’une voix
d’homme-enfant. Quelque chose de cette prime enfance persiste comme
issue à l’origine et appelant à s’y retrouver adulte d’un jardin d’enfant, celui
de Ma Mère l’Oye, Le Jardin féérique, de Maurice Ravel. Parfois, on entend en
effet une fête d’enfants. Ou bien on songe à une histoire entre l’enfant et
l’homme barbu, à Robert Wyatt dans les deux rôles comme dans Alifib sur
Rock Bottom, cet album incomparable et inclassable de 1974. « Rock
Bottom », c’est le plancher, le niveau le plus bas qu’on puisse atteindre,
c’est aussi l’infra fondamental, l’origine d’avant l’origine, en effet. Ou bien,
on songe à une maison, une de celle qu’on offre aux enfants à Noël, une
maison avec des poupées et des jouets. On entend des enfants jouer et
faire de la musique avec des instruments-jouets…
Peut-être et même sûrement, rien ne compte davantage, et ne conte que les
livres pour enfants avec leurs histoires sans fond. La vie n’est certainement
pas un songe quand on sait ce que Dieu a permis que les hommes fassent
et subissent – il y a dès lors, définitivement, quelque chose de très peu
sérieux dans le sérieux de la vie… –, mais il y a des existences, toutes
précieuses, comme il est raconté pour l’une d’elle dans L’Enfant et les
sortilèges, toujours de Ravel, décidément, lorsque le superficiel est rejoint
par le profond. On peut penser aussi à l’existence de Pierre avec les
animaux dans Pierre et le loup de Prokofiev, mais dans cette œuvre le drame
est si caché, si confisqué d’une certaine manière là où chez Ravel il n’est
jamais bien loin, les choses et les événements menaçant toujours de
dérailler ou d’être exposés au mal et plus couramment à la méchanceté.
L’angoisse, elle, est omniprésente et donc incontestable chez Ravel (la
scène, qui rappelle tous les traumatismes, de l’école ! Celle des chats, celle
de la nuit). Du reste, dans l’œuvre de Ravel, stimulée par l’art de Colette,
la scène est quasiment celle de l’opéra. On est très proche de celui de
Janacek, c’est du moins ce que l’écoute retient, non sans angoisse
concernant une œuvre qui met en scène, oui, l’enfant, et qui retrace des
étapes décisives, pour beaucoup de survie, quand on regarde en arrière, de
l’enfance. C’est ironique, c’est parfois, même souvent drôle, parodique et
justement c’est terrible. Et on revient de ce songe musical comme sonné
avec l’idée qui s’impose à l’esprit selon laquelle on vient de toucher, malgré
toutes les apparences, à quelque chose d’essentiel et sans doute aussi, sous
une apparence très trompeuse encore, justement, le fond. Rock Bottom. On
ne sait quoi penser de ce bruit du canard qui conclut l’album Rock Bottom…
III
On connaît, jusqu’au rabâchage, l’injonction : Deviens ce que tu es ! Mais comment devient-on ce que l’on est, et que veut dire exactement la formule ? On en a fait mention, Robert Wyatt est tombé du 4° étage un jour de fête très arrosée en 1974. Il deviendra paraplégique. On croira, comme on l’a cru, que cet événement marqua une fin. Or, ce fut un commencement, un engendrement et comme dit Deleuze avec ironie comme avec génie, l’effet de « l’immaculée conception ».
Tant de personnes ne deviendront jamais ce qu’elles sont, non par négligence, ni d’ailleurs par immoralité ou mensonge à leur propre égard, mais parce qu’il n’y eut aucun événement qui leur en donna l’occasion. Car ce devenir ne relève pas d’une décision formelle et donc abstraite, mais de ce qui arrive. Lorsque Robert Wyatt prit connaissance, après le coma, de
son état de paralytique, il dit à sa mère, je crois : « Hum, vachement typique ! » (1),
il se reconnut, il sut enfin qui il était parce qu’il venait d’en avoir la
confirmation. Il reconnut à la fois une logique et une vérité. On peut
conserver des considérations d’Alain Badiou ceci, qui est incontestable, à
savoir qu’il n’existe de vérité que dans la fidélité subjective à un événement.
L’idée peut tout autant être dérivée de Deleuze, de cette page de Logique
du sens consacrée à Joe Bousquet (2), qui a précisément pour titre De
l’événement, à laquelle on ne peut que renvoyer et qu’on croit lire en filigrane
de ce qui est arrivé à Robert Wyatt et dans les propos qui furent les siens.
On se souvient de la phrase de Joe Bousquet à partir de laquelle Deleuze
construit sa très belle démonstration : « Ma blessure existait avant moi, je suis
né pour l’incarner », phrase tirée, cela n’est pas noté, de ce livre prodigieux
de profondeur intitulé Traduit du silence (3).
Malheur à ceux qui n’ont jamais connu ce que c’est qu’un événement, celui,
qui n’est qu’à cette condition, qui les regarde, en tous les sens de ce verbe !
Malheur, alors que communément, un malheur est précisément tout autre
chose, le contraire même de celui qui ouvre, dans le désastre, une existence
dans laquelle on devient ce qu’on est. C’est lui qui dans la souffrance, la
privation, le deuil, l’accident, la catastrophe, le handicap autorise l’accès à
soi, faisant de soi un Soi, qui ne se préexistait pas et qui, en même temps
et pourtant, attendait comme s’il s’attendait, comme s’il n’attendait que sa
propre attente comme sa venue même. Et cela, cette épreuve, ou bien cette
bifurcation, est si radicale, si douloureuse, en rien souhaitable et désirable
en tant que telle évidemment, qu’elle réclame le stoïcisme comme sa
doctrine, à la condition qu’elle soit correctement comprise, non pas
comme résistance et acceptation de ce qui arrive, mais comme volonté de
ce qui arrive dans ce qui arrive. Car l’événement n’est pas ce qui arrive,
remarque Deleuze, mais ce qui se tient et arrive dans ce qui arrive. Et c’est
bien là que l’événement se joue comme tel, puisque d’un côté il est si facile
de se laisser aller, jusqu’au ressentiment, et que de l’autre s’ouvre une voie
dans laquelle se promet le « Soi » qu’il s’agit de devenir, en se hissant par
la volonté jusqu’à lui, jusqu’à son promontoire.
Qu’on lise seulement les déclarations de Robert Wyatt, lorsqu’il se
retourna sur ce qui lui était arrivé. D’abord, celle qui raconte l’accident
avec une précision et une profondeur extraordinaire auxquelles peu de
philosophes parviennent :
« C’est difficile d’expliquer ce qu’on ressent en tombant. Vous n’avez pas idée. C’était
affreux, pas pour moi, mais pour les autres. Moi, je suis tombé. C’est comme perdre
toute sensation d’un coup. Je n’ai pas perdu connaissance. Je ne suis pas tombé sur la
tête, mais sur mon talon gauche, même si le reste a rapidement suivi. Je me souviens
d’avoir entendu un cri semblable à un hurlement de loup. Plus tard, j’ai mentionné ce
détail et quelqu’un m’a dit : « C’était toi ». Mais je me rappelle un cri lointain. J’ai
donc entendu mon propre cri faisant écho au loin. J’étais en quelque sorte détaché de ce
cri. Je me rappelle avoir été attaché dans l’ambulance. Bref, six semaines plus tard –
parce qu’apparemment on est tellement drogué à l’hôpital qu’on ne se rend compte de
rien –, je me suis réveillé dans un lit d’hôpital, et un nouveau monde s’offrait à moi.»
Texte et paroles, en effet, d’une richesse incroyable qui ne peut pas ne pas
faire songer à l’événement de la chute de Jean-Jacques Rousseau à
Ménilmontant évoquée dans la Seconde Promenade des Rêveries du
promeneur solitaire. L’existence est mise à distance, ou apparaît dans cette
dimension. Pour Robert Wyatt la voix permet d’en prendre la mesure, à
moins que l’existence se regarde depuis la mort comme si elle surgissait
dans l’évidence de son apparaître en tant que telle, vraiment, à cette
occasion.
Une pure, la pure existence, voilà ce que Robert Wyatt découvre. Il la voit,
il l’entend. Il renaît. Oui, il renaît de ce coma. Et puis non, il naît à lui-même. La preuve en est cette autre déclaration :
« Vous devez penser que c’était difficile, mais c’était fantastiquement libérateur. C’est
peut-être l’une des raisons pour lesquelles je n’ai pas de problème à me retrouver en
fauteuil roulant. Paradoxalement, c’était libérateur. Tout à coup, je ne pouvais plus être
tous les hommes que j’avais essayé de devenir, batteur ou chanteur. Je devais m’asseoir
et me dire : “Arrête de dépendre des autres. Fais-le toi-même, c’est tout”. »
On le
reconnaîtra, on dirait que Robert Wyatt a passé beaucoup de temps à lire
la page de Deleuze à laquelle on a fait référence, qu’il connaissait la phrase
de Joe Bousquet, qu’il a expérimentée pour la penser et qu’il a pensée
comme l’expérience même, unique et singulière de soi.
Là aussi la preuve en est cette dernière déclaration :
« Les gens pensent que je dois avoir du mal à parler de mon accident. Mais c’est faux ;
ce dont j’ai du mal à parler, c’est de ce qui est arrivé avant l’accident. Rock Bottom
et ce qui a suivi, je considère que c’est moi. Mais le moi adolescent, le batteur bipède, je
ne me souviens pas de lui et ne le comprends pas… Maintenant, je vois mon accident
comme une ligne de séparation claire entre mon adolescence et le reste de ma vie. »
On
commence ainsi à comprendre mieux ce que c’est qu’un événement. Non
pas l’accident, donc, pris en lui-même, encore moins les réactions de
douleur, de nostalgie et de ressentiment qui peuvent apparaître comme la
suite logique de ce qui est arrivé, mais ce qui s’est produit dans le sujet et
l’a pour ainsi dire élevé à ce statut. Certainement, l’usage du terme de
« sujet » n’est guère approprié dans un texte de Deleuze en raison de son
passé et de son historique, mais il s’impose ici, malgré tout, en raison de
sa puissance de marquage d’un commencement. Ainsi lorsque Deleuze
enchaîne sa référence à Joe Bousquet par cette remarque concernant la
morale, en posant que « ou bien la morale n’a aucun sens, ou bien c’est cela qu’elle
veut dire, elle n’a rien d’autre à dire : ne pas être indigne de ce qui nous arrive », il est
proche d’une pensée nouvelle de ce que la notion de « sujet » peut vouloir
dire, à savoir l’appropriation dans l’accident, littéralement ce qui arrive et
nous arrive, non pas de ses effets, qui en eux-mêmes ne sont que handicap
et souffrance, mais de sa puissance d’éclairement, de dégagement du temps
et d’un avenir, et par conséquent de soi. Deleuze va parler de « vérité »
lorsqu’il va s’agir de préciser ce que « vouloir l’événement » veut dire en
précisant que « c’est d’abord en dégager l’éternelle vérité ». Et pour conclure, ceci,
qui fait écho avec tellement de proximité, et même boucle parfaite, avec
ce qu’on vient de lire et d’entendre de Robert Wyatt :
« Bousquet dit encore : “Deviens l’homme de tes malheurs, apprends à en incarner la
perfection et l’éclat”. On ne peut rien dire de plus, jamais on n’a rien dit de plus : devenir
digne de ce qui nous arrive, donc en vouloir et en dégager l’événement, devenir le fils de
ses propres événements, et par là renaître, se refaire une naissance, rompre avec sa
naissance de chair. »
IV
C’est seulement à présent que l’on peut essayer de dire quelques mots sur
l’œuvre. Le mieux, peut-être, mais ça n’est sans doute pas si arbitraire que cela, serait d’évoquer d’une part Moon in june dans Soft Machine Third, soit
une des quatre pièces que comportait alors le double album en vinyle,
chacune durant à peu près vingt minutes, et d’autre part l’album, qu’on a
cité à plusieurs reprises, parce qu’il est emblématique, Rock Bottom. Le
premier choix est induit par la performance musicale elle-même, à la fois
la voix à plein régime déployée de Robert Wyatt dans ce morceau et son
jeu de batterie dans un album extrêmement sophistiqué et écrit ; le second
est, comme dit, l’inventivité même, l’originalité, un objet poétique et
musical vraiment étonnant.
Moon in june. Soft Machine se distingue des autres groupes Pop, se
caractérise même par l’absence de guitariste dans son effectif, ce qui
constitue, on le reconnaîtra, une incongruité dans la musique Pop d’alors et peut-être même dans les musiques d’aujourd’hui. En revanche, on
notera, mais ce fut un trait d’époque, qu’on se souvienne de Chicago Transit
Authority et de Blood, Sweat and Tears, mais dans les deux cas, la guitare était
maintenue – et comment dans le premier cas avec Terry Kath ! –, la
présence et l’importance des cuivres. Cette formation fut saluée par Keith
Tippett lui-même. L’originalité de cette musique était déjà très singulière,
elle n’avait rien à voir avec le succès de Weather Report ou même du
Maravishnu Orchestra de John McLaughlin auxquels elle fut très et trop
vite assimilée. La preuve en est en quelque sorte cette déclaration de
Robert Wyatt : « Je voulais quelque chose, je l’avais en tête, mais je n’arrivais pas à
l’identifier. Un style musical qui n’existait pas encore et pour lequel je n’avais pas de
nom ». Cette innommable mérite d’être souligné, car d’une part il
enveloppe le chant et la voix de Robert Wyatt, cette dimension de
l’enfance, qui en vérité n’est que le déplacement de toute réalité dans le
réel de la musique, celui que l’enfance symbolise, et d’autre part le projet
proprement stylistique, l’exigence d’une exactitude musicale. La
déclaration se poursuit ainsi, au sujet de Soft Machine : « Au mieux de sa
forme, je pense qu’il n’existait rien de tel. C’était un groupe incroyable ».
Assurément, on ne comprend pas vraiment l’album Third si on n’a pas
connaissance des performances de Cecil Taylor, ce pianiste de jazz qui
venait des heures avant le concert pour commencer à jouer et qui finissait,
si l’on peut dire, au-delà de sa fin… Rien ne commence, rien ne finit, les
choses suivent leur cours aurait dit Samuel Beckett. Et à propos de la partie
chantée, qui n’est pas réellement composée de phrases, Robert Wyatt
précise en bon pataphysicien que « le titre “Moon in june” semble très structuré.
Mais en réalité, il s’agissait d’une série de chansons inachevées et, au lieu de les terminer, je les ai mélangées. Quel bazar ! » Mais il fallait ces dimensions pataphysiques
du « bazar » pour que cette voix et le chant qu’elle porte aient quelque sens.
D’une part, la dimension purement vocale, c’est-à-dire acoustique –
mieux : musicale, ce qui est tout autre chose que « la musique » –, ou encore
le chantonnement se tiennent au premier plan et non pas le régime et le
registre des significations et de la communication ; d’autre part, cette pure
expression n’est possible que par la singularité à la fois sonore et
linguistique qui caractérisent une voix, et cela malgré l’influence reconnue
de Mimi Perrin, la chanteuse des Double Six, elle qui aura appris à Robert
Wyatt comment accompagner vocalement le morceau Naima de
Coltrane… Robert Wyatt résume ainsi la situation : « Je ne pense pas que tout
le monde doive chanter de cette façon, mais moi, je dois chanter comme ça ». On
ne peut que souligner cette dernière expression, qui porte un dictamen, à
savoir de façon combinée un impératif expressif, une « vocation » au sens
fort du terme ainsi que, encore un trait de pataphysique, le régime
d’exception qui sera de plus en plus le sien. Et on ne peut pas ne pas voir
dans ce commandement l’annonce, presque le signe de l’événement à venir
dont Robert Wyatt fera la condition de sa subjectivation.
L’exception subjective s’exceptera de plus en plus du groupe Soft
Machine, Robert Wyatt note que ses collègues ne l’écoutent même plus
chanter en concert, tellement il serait en train de dériver et de ne rien
apporter musicalement. Alors que, en toute logique, Robert Wyatt a
conscience, dans la ligne de l’Asphyxiante culture de Jean Dubuffet (4), de se
soustraire à la « haute culture », qui, si elle n’est d’aucune manière
condamnable dans ce qu’elle a produit, aurait néanmoins perdu de vue la
musicalité, c’est-à-dire l’éthique de la musique, qui est autre chose, en tout
cas bien davantage, que « la musique », mais qui concerne le cœur même
de l’existence, la manière dont on la considère et ce que l’on en fait. Marcus
O’Dair, dans son très beau livre, précise que Robert Wyatt « a plus tard
insinué qu’il refusait d’apprendre à lire la musique, pour que le reste du groupe ne puisse
pas lui indiquer quoi jouer » ! Enfin, rien ne va davantage en ce sens que la
condamnation que fait Robert Wyatt de toute virtuosité (ce qui ne
l’empêcha pas d’être un batteur virtuose) : « J’ai commencé avec des idées
ésotériques et la musique moderne européenne, avec Stockhausen, Webern, les poètes
tout ce qui était avant-gardiste pendant les années 1950, avant la musique pop, les
poètes de la Beat Generation, les peintres de l’époque, etc. À mes yeux, le plus fascinant
avait été de découvrir la beauté absolue de Ray Charles chantant, par exemple, une
chanson country ou western. Donc, mon vrai voyage de découverte eut lieu quand j’ai
découvert la beauté de la musique simple et populaire ». L’enfance n’est donc pas
seulement subjective, le Jardin féérique est aussi celui, perdu, des traditions,
la musique n’est possible, comme la beauté même, que par l’événement, la
blessure : ne plus pouvoir voir, ne plus voir ce que les autres voient, voir
autre chose ; ne plus pouvoir se mouvoir, se mouvoir autrement, comme
un oiseau. Tomber, avec Joe Bousquet, avec Deleuze, mais tomber vers le
haut, s’envoler.
Rock Bottom, donc, pour finir.
« Je me suis dit : “Je dois inventer une manière de créer sans aucune référence” ». La
déclaration parle d’elle-même. L’album a paru en 1974 et fut
immédiatement reconnu pour son originalité. Il est présenté comme un
album en solo mais le personnel musical comporte bon nombre d’invités
prestigieux, le guitariste Mike Oldfield par exemple. Les invités sont
également présents dans la conception, ainsi le magnifique album, toujours
un peu inégalé, de van Morrison, Astral Weeks (1968), dont, précise Robert Wyatt, les « visions enfantines […] sautent aux yeux ». Déjà la pochette, réalisée
par Alfie, la compagne puis l’épouse de Robert Wyatt, qui composera
toutes les autres pochettes des albums en solo, montre un paysage marin,
un autre fond que celui de la chute, celui des limbes, en l’occurrence un
microcosme aquatique. Et toute la musique va sortir de ce paysage. La
musique ? C’est-à-dire comme le fond de la musique même, des rythmes
que Robert Wyatt exécute avec un plateau à thé et un petit tambour
d’enfant puisqu’il ne peut plus vraiment jouer de la batterie, des imitations
comme celle d’un cor sur le morceau A Last Straw. Nous écoutons cette
musique, nous sommes replongés dans un « monde » d’avant le langage, là
où se forment les mots et les phrases qui se répéteront à leur manière,
reformés et déformés, puis reconstitués par la musique et la poésie tout au
long de la vie des très grands artistes à l’écoute de ce qui leur vient de ce
« monde ». Dans ses déclarations, Robert Wyatt fait également, en plus,
référence à l’animal, non, certainement, pour cultiver on ne sait quelle
dimension primale, qu’on ne perçoit au demeurant pas dans l’album, mais
pour détruire un art faux, alambiqué, un art de pur produit sans
engagement existentiel ou expressif profond. Voilà, la musique de Robert
Wyatt est profonde, elle apparaît superficielle, pataphysique oblige, mais
elle est profonde. Elle ne cesse en effet de forer en vous à la recherche de
compositions de mots premiers et d’agencements de phrases. Ce que dit
de l’album Robert Wyatt est sans ambiguïté : « J’ai plus l’impression qu’il s’agit
de retrouver l’animal à l’intérieur de l’homme sophistiqué ».
Par ailleurs, il se réjouit de « la beauté de la chose mal faite », parce qu’il
comprend que le chef-d’œuvre, disons « conceptuel », ne correspond à
rien dans l’ordre de l’expression qui est censé constituer le contenu de tout art. Il faut habiliter la notion de « chef-d’œuvre raté » (5).
Car un chef-d’œuvre
quelque peu réel comporte une dimension de ratage, dit plus simplement
d’imperfection. Plus exactement encore, mais on l’a compris, c’est de la
dimension enfantine qu’il s’agit. Décidément, une fois de plus, « l’artiste est
un enfant », ou alors un être qui a su s’accrocher à l’enfance comme on le
ferait pour capter une tonalité, une modulation, celle-là même qu’on
entend, et qui touche, dans la voix de Robert Wyatt. Et il y a ce personnage
excentrique qu’on entend déclamer à la fin de l’album, Ivor Cutler, qui
conclut ce paysage musical de sa propre voix, étrange, vraiment venue
d’ailleurs.
Voici le résumé de l’album fait par Robert Wyatt lui-même :
« De la même façon que Paul Klee et Picasso ont commencé à faire des gribouillages
d’enfant quand ils ont vieilli, je trouvais que c’était émouvant et intéressant, cet abandon
de la technique. L’histoire du jazz était un peu dans cette veine, dans le sens où Ornette
Coleman jouait du violon – ce qu’il ne savait pas faire. Je trouve ça très courageux. Ou
encore, Ivor Cutler dessinant de sa main gauche parce qu’il considérait trop simpliste de
le faire de la main droite. »
Il existe donc un « style tardif », selon l’expression d’Adorno à propos de
Beethoven surtout, expression reprise et travaillée également auprès de
quelques écrivains par Edward Saïd, mais un style tardif très spécial qui
retourne non pas à l’élémentaire comme le fait le compositeur allemand,
mais qui perce le voile qui avait recouvert l’enfance. Peut-être en littérature
Adalbert Stifter y est-il parvenu, lui qui aimait les enfants, mais avec des
ressources artistiques trop importantes à cet égard. Ravel sans doute, on
en a d’emblée fait la remarque. Ce qu’on entend chez Robert Wyatt, ce qui
s’avère bouleversant, c’est que cette musique est si douloureuse dans la
joie qu’elle manifeste qu’elle se montre joyeuse de pouvoir renverser tous
les régimes du manque, de la perte et de l’abandon.
André Hirt
L’ouvrage cité en note de Marcus O’Dair, Robert Wyatt, Different every time, trad. Pauline Firla et Louis Moisan, Préface de Jonathan Coe, Le Castor Astral, 2016.
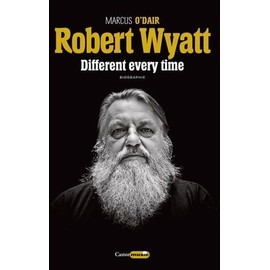 |
(1) On renverra, pour toutes les informations factuelles, événements et citations, dont il est fait état ici par la suite, au
livre détaillé, remarquable et de part en part passionnant de Marcus O’Dair, Robert Wyatt, Different every time, trad.
Pauline Firla et Louis Moisan, Préface de Jonathan Coe, Le Castor Astral, 2016.
(2) Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris, Minuit, 1969, p.174 sq.
(3) Le livre de Joe Bousquet, Traduit du silence, est réédité chez Gallimard, dans la collection « L’Imaginaire ».
(4) Jean Dubuffet, Asphyxiante culture, Paris, Minuit.
(5) Habilitation tentée dans André Hirt, Staccato, Paris, Kimé, 2016, pp. 177-184.
|