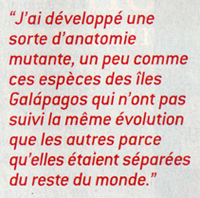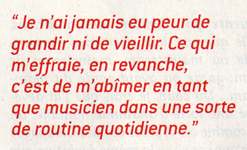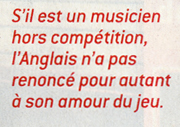| |
|
|
 Vol au-dessus d'un nid de coucou - Les inrockuptibles - N° 411 -
octobre 2003 Vol au-dessus d'un nid de coucou - Les inrockuptibles - N° 411 -
octobre 2003
 |
|
 Robert Wyatt, le vieux sage pas sage de la musique anglaise, revient avec un album somptueux, Cuckooland. Un disque où pop, jazz et musiques nouvelles continuent leur malicieux frotti-frotta. C'est dans son village de Louth que Wyatt nous a ouvert sa maison, son cœur et sa musique.
Robert Wyatt, le vieux sage pas sage de la musique anglaise, revient avec un album somptueux, Cuckooland. Un disque où pop, jazz et musiques nouvelles continuent leur malicieux frotti-frotta. C'est dans son village de Louth que Wyatt nous a ouvert sa maison, son cœur et sa musique.
Par Richard Robert Photo Renaud Monfourny
|
Pour se rendre chez Robert Wyatt, il faut d'abord laisser Londres et filer droit vers le nord. Prendre l'un de ces trains pour Newcastle ou Leeds qui, au petit matin, sonnent forcément le creux - pourquoi diable des gens de la capitale iraient-ils se perdre là-haut ? Puis, après deux heures de voyage, sauter dans un tortillard de campagne, qui se traîne comme une chenille au milieu de paysages où rien n'arrête l'espace ni le regard, sinon quelques vaches et moutons accrochés comme des poux à la laine jaunie des pâturages. Enfin, descendre dans une petite gare déserte, pour suivre, quelques miles durant, une route qui sinue par pur caprice, puisque aucun obstacle visible ne justifie qu'elle ondoie. La ville de Louth apparaît au terme de ce long chemin, toute fardée de briques et habillée de calme. Un Londonien se dirait sans doute qu'il est arrivé là au bout du monde, et que le bout du monde est un coin bien perdu. Assez vite, il pourrait pourtant s'apercevoir que cette grosse bourgade n'est pas plus paumée ni moribonde qu'une autre. Elle mène sa vie, ramassée et grouillante, sans se soucier de sa place dans l'univers ni du rôle qu'elle tient dans la marche de la planète. Elle possède ses centres de gravité - son marché, ses pubs, son église, sa rue commerçante - et se fiche de ne pas être soumise à l'influence de ce que l'on appelle aujourd'hui les "pôles de décision". Si bien qu'après une douce journée à Louth, tout vous paraît facilement renversé : c'est Londres qui, comme sous l'effet d'un subtil mouvement de balancier, est repoussé à la périphérie, très loin au fond du décor, perdu dans quelque province embrumée.
La musique de Robert Wyatt détient exactement ce genre de pouvoir. Elle change les perspectives d'écoute, brouille les critères censés distinguer la "norme" de la "marge". Elle culbute aussi cette logique selon laquelle la pop, le jazz ou les musiques nouvelles seraient des entités figées et distinctes. Ceux qui ne la connaissent que de loin la croient étrange, difficile à cerner, voire indéchiffrable. Ceux qui ont pris la peine de l'explorer savent qu'elle constitue un monde à part entière, où il fait bon se réfugier quand l'époque vire à la grisaille. Ce monde est l'antre chaleureux et profond d'un homme qui n'est pas plus un anachorète qu'un doux illuminé. Trop occupé à suivre la pente de ses goûts et de son inspiration, Wyatt s'est détaché comme par distraction des us et coutumes du milieu musical. Comme Mark Hollis ou Pascal Comelade, deux de ses nombreux héritiers, il n'est pas ailleurs : il campe simplement au cœur de sa propre musique et rien ne saurait le déloger d'une place aussi privilégiée.
L'Anglais jouit d'un prestige nouveau depuis Shleep (1997), un album gorgé de sève et d'idées qui aura mis fin à une longue période d'hibernation. Son nom est réapparu dans la liste des créateurs les plus influents de ces trente dernières années. Toute une volée de jeunes musiciens le cite volontiers en exemple - notamment en France, où Bed, Syd Matters ou Man n'existeraient peut-être pas sans lui. Mais certains des éloges qui lui sont adressés contiennent aujourd'hui encore une part d'incompréhension. Très récemment, on lisait ainsi dans une gazette ce commentaire à double tranchant sur son nouvel album, Cuckooland : "Wyatt sort des disques en général magnifiques, mais difficilement accessibles au commun des mortels." Pas franchement ce qu'il y a de plus encourageant.
|

|
"C'est un avertissement plutôt sympathique, juge l'intéressé. Je comprends que les gens prennent ce genre de précautions avec moi. Je n'ai jamais cherché à être délibérément obscur, mais je ne me suis jamais retenu de faire quelque chose sous prétexte que ça risquait d'apparaître comme tel. Bien sûr, je me dis très souvent que je sors des disques on ne peut plus normaux, puisque j'y mets la musique que j'ai toujours rêvée d'entendre. Mais dès que la radio diffuse l'une de mes chansons, je mesure à quel point elle ne ressemble à rien de ce qui se fait aujourd'hui... Mon isolement relatif est peut-être à l'origine de ce décalage. Ça fait des années que je ne fréquente pas l'univers des musiciens, quelle que soit leur obédience - avant-garde ou mainstream, mainstream de l'avant-garde ou avant-garde du mainstream... Du coup, je crois que j'ai développé une sorte d'anatomie mutante, un peu comme ces espèces des îles Galapagos qui n'ont pas suivi la même évolution que les autres parce qu'elles étaient séparées du reste du monde. Etre "différent" ou "comme les autres" n'a jamais représenté le moindre enjeu à mes yeux. D'une manière générale, tout ce qui, dans ma musique, renvoie à ma personnalité ne m'intéresse pas. Ce qui m'importe, c'est de composer de belles pièces organiques, qui puissent vivre par elles-mêmes."
Le parcours de Robert Wyatt est celui d'un musicien qui, lentement mais sûrement, s'est mis hors compétition. Pour lui, tout a pourtant commencé comme une de ces bonnes vieilles légendes dont l'histoire du rock aime à nourrir sa chronique.
Né en 1945, il tiendra, au milieu des années 60, la batterie dans un groupe qui, aujourd'hui encore, fait figure de référence pour tous les amateurs de musiques aventureuses. Alors que les Beatles et les Stones se tirent la bourre devant le monde entier, Soft Machine ouvre un front pionnier en rassemblant des forces apparemment disparates. L'esprit libre du jazz, la puissance énergétique du rock et du rhythm'n'blues, les inventions de langage chères au surréalisme ou à dada se mêlent dans un bric-à-brac pataphysique qui illustre à merveille cet amour du désordre dont les années 60 se firent l'écho.
A cette époque, Wyatt fait déjà plus que cogner sur ses fûts. Avec sa voix haut perchée et ses compositions en escalier, il apporte à Soft Machine cette sensibilité joueuse et cette poésie lunaire dont il ne se départira jamais, même aux heures les plus sombres de sa carrière. Après le départ de Daevid Allen (futur Gong) et surtout celui du troubadour pop Kevin Ayers, il se heurte pourtant très vite à la rigidité des deux membres restants, partisans d'une ligne plus sérieuse et purement instrumentale.
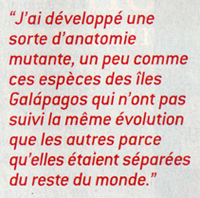 |
Lorsque Wyatt quitte le groupe en 1971, laissant ses partenaires s'enliser dans l'ornière prog-rock, le mal est déjà fait. Ses deux albums à la tête du collectif Matching Mole (traduction phonétique et ironique de "machine molle", Soft Machine en français) ne dissiperont que momentanément les doutes qui l'assaillent. "A titre personnel, les années 60 ont été un véritable désastre, une humiliation. J'ai côtoyé des musiciens de grande qualité, tant dans la pop que dans le jazz, mais ces expériences collectives se sont toujours terminées par un fiasco. Pendant une bonne quinzaine d'années, je me suis senti coupable, j'avais tout simplement honte d'exister."
L'accident qui, en juin 1973, lui coûte l'usage de ses jambes (à la suite d'une soirée passablement arrosée, il chute du quatrième étage d'un immeuble londonien) marque violemment la fin d'une ère. Avec Rock Bottom (1974), chef-d'œuvre flottant dont il a tracé les plans sur son lit d'hôpital, Wyatt passe de l'autre côté du miroir rock. Enrobée dans un nuage de cymbales, de claviers et de trompettes qui tremblent comme des gouttes sur une branche au soleil, sa musique s'émancipe de toute tradition et présente des propriétés plastiques qui le rapprochent de ses premières amours, la peinture.
Devenu paraplégique, Wyatt semble avoir redécouvert les vertus originelles du chant et du geste musical. Sa voix de tête, d'une blancheur presque aveuglante, et ses instrumentations liquides dessinent des figures mélodiques faussement transparentes, où tout est affaire de lignes, de points, d'irisations, de grain et de texture.
Tétanisé en studio, méprisé par des ingénieurs du son qui n'entendent rien à ses partis pris esthétiques, Wyatt distille au compte-gouttes des albums âpres à l'oreille et longs en bouche - Old Rottenhat en 1985, Dondestan en 1991 - où l'absence de toute ornementation inutile valorise un peu plus les incroyables inventions de son écriture. Avec ses claviers pourris et sa voix flûtée, Wyatt signe alors une véritable musique d'île déserte.
Ses engagements politiques (il adhère au PC anglais de 1979 à 1987, au moment où le libéralisme thatchérien triomphe et où le bloc communiste se désagrège) et son refus viscéral de se produire sur scène ("Je m'évanouis de peur à la simple idée que des gens comptent sur moi pour animer leur soirée") achèvent de le mettre en retrait du grand cirque pop.
Pourtant, cet homme au visage broussailleux de Robinson Crusoé n'est pas totalement naufragé ni solitaire. Certains amis fidèles, comme Brian Eno, Michael Mantler ou Geoff Travis, le boss du label Rough Trade, sont de ceux qui l'incitent à enregistrer, fût-ce par intermittences. Surtout, Wyatt a trouvé son Vendredi en la personne d'Alfreda Benge, dite Alfie, son épouse depuis 1974. Elle est à la fois sa muse (il lui a dédié Rock Bottom) et son point d'ancrage avec le monde, son bras armé (c'est elle qui, au bout d'un long combat avec Virgin, récupère les droits de ses premiers albums solo) et son guide, sa conseillère et sa parolière - elle a signé cinq textes de Cuckooland. "Je l'enjoins à intervenir de plus en plus dans ce que je fais. Elle ne m'apporte pas seulement des textes ; elle m'a notamment poussé à composer une musique moins surchargée et complexe, qui ait de l'espace et du cœur. Shleep et Cuckooland n'auraient pas eu le même visage si elle n'avait pas été là. Lorsque je compose, j'ai besoin d'être dans une sorte de transe solitaire. Mais ensuite, il faut que je puisse partager, échanger. Avec Jamie Johnson, mon ingénieur du son depuis Shleep, Alfie forme le groupe que je n'ai jamais eu."
En bon émule de Darwin, Wyatt affirme que Cuckooland est le résultat de toute cette histoire, des quelques rencontres qu'il a pu faire sur ce tortueux chemin et des leçons que ses expériences lui ont enseignées. Une manière de dire que, six ans après Shleep, il a choisi comme toujours de changer dans la continuité. De fait, les premières mesures de Cuckooland, où quelques coulures de cornet glissent sur une nappe de synthé bon marché, ramènent l'auditeur en terrain familier. Mais le terrain est si fertile, si prodigue de beautés et d'inventions, qu'on se laisse une fois de plus surprendre.
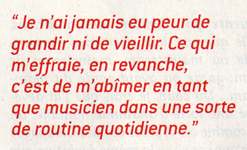 |
Il y a d'abord la classe phénoménale d'un musicien qui réussit à enchaîner les figures harmoniques, mélodiques et rythmiques les plus acrobatiques sans jamais donner l'impression de s'adonner à de pénibles tours de force. Il y a cette voix à la fois neuve et ancestrale qui unifie cette improbable mosaïque, cette voix d'enfant centenaire qui n'est pas - n'en déplaise à Ryuichi Sakamoto - "la plus triste du monde" : simplement la plus littérale et la plus musicale du monde, comme en témoigne la relecture limpide d'Insensatez, le standard de Tom Jobim.
Il y a aussi l'extraordinaire fond de jeu d'une équipe d'instrumentistes qui, de Karen Mantler à David Gilmour, du clarinettiste israélien Gilad Atzmon à la tromboniste Annie Whitehead, donne à chaque trait mélodique la couleur et la vibration requises. Il y a enfin cette place nouvelle accordée au jazz, qui n'apparaît plus seulement en filigrane, mais de manière très explicite, comme sur ces véritables airs à swinguer que sont Old Europe ou Trickle Down. "Lorsque vous commencez à atteindre un certain âge, vous êtes peut-être tenté de retourner dans les parages de l'enfance et de l'adolescence. Mes racines, ce sont les années 50 - et non les années 60, comme beaucoup de gens peuvent le croire. J'ai tellement détesté l'école quand j'étais gamin que je me suis évadé dans l'univers chimérique du jazz et de la peinture. Je ne me considère pas aujourd'hui comme un jazzman, mais le jazz est le chemin par lequel je suis vraiment entré dans le monde. Note par note, rythme par rythme, Cuckooland est aussi une façon de retrouver ce lien avec ma culture d'origine."
Cet hommage à la musique qui l'a éveillé n'est pas le seul moment fort d'un disque extrêmement dense : toutes les chansons, ici, peuvent facilement faire l'objet de plusieurs niveaux de lecture (musical, poétique, politique, sentimental...), sans que la limpidité ni la légèreté de l'ensemble en soient pour autant altérées. Comment Wyatt réussit-il à créer une musique aussi chargée et aussi aérienne ? Face à une telle question, l'Anglais répond qu'il n'est pas psychologue pour un sou et qu'il n'est pas doué pour l'introspection.
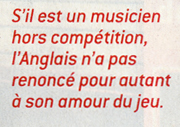 |
Un court détour par sa salle de musique, au rez-de-chaussée de sa maison de Louth, apporte un élément de réponse. Dans cette petite pièce dorment un magnéto 8-pistes, une table de mixage, un piano, une guitare qui appartient à Kevin Ayers, des percussions et des cymbales. Et aussi un cornet, avec lequel Wyatt se plaît à accompagner les disques de Jimmy Scott, Astrud Gilberto ou Ray Charles. "Voilà à quoi ma vie de musicien ressemble le plus souvent : à un karaoké", lâche-t-il, amusé. La joie presque enfantine avec laquelle Wyatt évoque cette modeste activité dit à elle seule ce qui fait sa singularité : s'il est un musicien hors compétition, l'Anglais n'a pas renoncé pour autant à son amour du jeu. Et c'est bien ça qu'on entend de bout en bout dans Cuckooland, comme dans une épatante compilation d'inédits qui vient de sortir, Solar Flores Burn for You (1972-2003).
"Je n'ai jamais eu peur de grandir ni de vieillir. Ce qui m'effraie, en revanche, c'est de m'abîmer en tant que musicien dans une sorte de routine quotidienne. Pour moi, il y a là une forme de sacrilège. Ecrire une chanson, c'est comme peindre la voûte d'une chapelle : dans les deux cas, on essaie autant que possible de créer de la
magie. Si j'aime Van Gogh, par exemple, c'est parce qu'il est capable de voir la beauté impérieuse d'une vieille chaise ou d'un bol de pommes de terre, de les peindre comme s'il venait d'une autre planète et voyait ces objets pour la première fois... Pour moi, ce genre de sensations renvoie forcément à l'enfance, qui est l'âge de la magie par excellence, une période de la vie où tout est choquant, extraordinaire, étonnant. S'il y a encore un enfant en moi, il resurgit ainsi, presque par hasard, dans l'acte de jouer et de chanter. Ça n'a rien à voir avec une forme d'immaturité ou d'innocence. Il se trouve simplement que, par moments, la musique m'aide à considérer le monde comme un endroit magique. En cela, elle est une alliée précieuse dans ma bataille contre le cynisme et le désenchantement. Avec elle, je trouve cette planète beaucoup plus intéressante.
C'est peut-être là l'enseignement délivré par l'œuvre de Robert Wyatt : l'amour de la musique, quand il est porté par une telle fraîcheur d'intention et d'expression, rend beau, intelligent, heureux et sensible. Une vérité qu'on est en droit d'estimer naïve, voire mièvre, mais qui trouve pourtant dans Cuckooland sa plus indiscutable transcription. Neuve comme au premier jour et belle comme l'antique, la musique de Wyatt renferme à la fois tout le possible du monde et les bruissements de la vie simple. Cette prouesse, accomplie avec l'humilité et la droiture d'un homme qui ne s'est jamais vu plus grand qu'il n'était, mérite bien qu'on la célèbre avec un peu de grandiloquence. Car elle rend, elle aussi, cette planète plus intéressante et, tout simplement, plus vivable".
Cuckooland (Rykodisc/Naïve) ; Solar Flares Burn for You (Cuneiform/Orkhëstra).
|