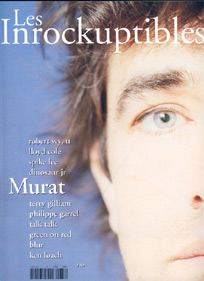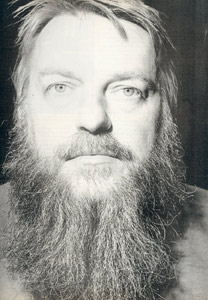| |
|
|
 Chevalier
de la Grande Gidouille - Les inrockuptibles N° 31 -
octobre 1991 Chevalier
de la Grande Gidouille - Les inrockuptibles N° 31 -
octobre 1991
CHEVALIER DE LA GRANDE GIDOUILLE
| |
C'est dans les sixties que Robert Wyatt et
sa Soft Machine jettent une pleine brassée
d'humour dans une époque dévolue à
la révolte. La décennie suivante voit
le batteur devenir chanteur. Il mènera dès
lors une carrière solo paresseuse - lorgnant
à la dérobée sur le mythe et
coupée de tout enracinement temporel. Avec
les années 80 et derrière un engagement
politique exemplaire se dessine un esprit plus subtil
que dogmatique. A l'heure où paraît
son nouvel album, celui qu'on prenait pour un vieux
baba prosélyte se révèle être
un véritable citoyen du monde chez qui morale
rime avec dignité et respect avec humanisme.
Interview Bates & JD Beauvallet
Photo Renaud Monfourny
|
|
|
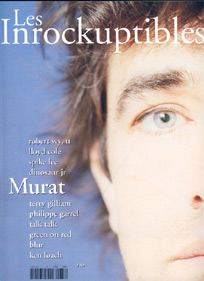
|
Ma mémoire commence déjà
à me jouer des tours et j'ai tendance à
inventer des excuses valables pour tout ce que j'ai fait
dans ma vie. Mais il me semble que si j'ai délaissé
la musique à certaines périodes, c'est simplement
parce que je trouvais d'autres centres d'intérêt.
En particulier, j'ai ressenti ce besoin de culture qu'ont
habituellement les jeunes lorsqu'ils vont à l'université.
Mais, ayant quitté l'école à 16 ans
et sans qualifications, j'ai été obligé
de gagner ma vie en entrant directement dans le monde
du travail: je n'avais tout simplement pas lu assez de
livres par rapport à mes envies. J'ai voulu m'éduquer
un peu plus. Il faut ajouter que je me suis également
éloigné du rock-business parce qu'il était
devenu presque impossible de communiquer avec les maisons
de disques vers la fin des seventies. . .
UN VISITEUR DE LA MUSIQUE
C'est Geoff Travis, de Rough Trade, qui m'a fait changer
d'avis. Il m'a dit "Pourquoi ne pas refaire un disque
au lieu de bouquiner, vieux tromblon ?" J'ai accepté,
d'autant qu'à l'époque j'avais besoin d'un
job, je ne pouvais pas vivre de l'air du temps ou manger
mes bouquins (rires). . . Il y aurait eu beaucoup
de métiers que j'aurais aimé exercer, mais
j'arrivais trop tard, ou je n'étais pas assez qualifié,
ou encore ce travail n'existait tout bonnement pas. Par
exemple, j'aurais aimé m'asseoir et écouter
des disques toute la journée, mais on ne m'a jamais
offert un tel boulot (rires). . . Et puis, il faut
reconnaitre qu'il n'est pas inscrit dans mes gènes
que je sois musicien, je n'ai jamais été
persuadé de l'être; c'est juste l'opportunité
qui s'est présentée à moi lorsque
j'ai quitté l'école. A cette époque,
il n'était pas envisageable pour un jeune Anglais
de vivre les sixties sans être dans un grand groupe
(rires). . . C'est vrai, j'ai toujours été
un visiteur de la musique, je n'ai jamais vécu
dedans.
D'où venait votre difficulté à
communiquer avec les maisons de disques dans les seventies
?
En Angleterre, il existe un problème spécifique:
tu es considéré comme illégitime,
tu n'existes pas, tant que tu n'as pas fait un hit. Et
j'avais du mal à fonctionner selon ce schéma.
J'ai essayé de faire un disque pop, c'est très
difficile. D'ailleurs, j'admire sincèrement ceux
qui font des disques très pop et très commerciaux.
Moi, je ne pouvais pas.
Vous étiez sur un jeune label Virgin, dirigé
par des gens de votre âge. . .
Mais, croyez-moi, le contrat de Virgin était exactement
le même que celui des autres compagnies. La seule
différence, c'est qu'à l'époque Richard
Branson avait les cheveux longs. Et c'était probablement
une perruque (rires). . .
Plus tard, vous avez fait Top of The Pops, vous avez
eu des hit-singles avec l'm a believer ou Shipbuilding.
. .
Humm... C'était des singles, c'est sûr (rires)...
Après ça, j'ai surtout eu plus de respect
pour les chanteurs pop professionnels qui réussissent
à mener une carrière, il faut se montrer
intelligent. Le mot français pour "single",
c'est "simple", n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est
pas le mot approprié (rires). . . C'est
très compliqué de faire un single. Je ne
pouvais d'ailleurs pas en écrire. C'est pourquoi
on avait choisi cette chanson des Monkees, et Shipbuilding
n'était pas non plus mon idée, elle venait
de Clive Langer et d'Evis Costello qui m'ont fait parvenir
une cassette et demandé d'essayer . . .
Comment vous sentiez-vous, soudainement accepté
par l'industrie musicale ?
Je n'y ai jamais prêté attention, jamais.
Je suis un peu comme ces bombardiers qui larguent leurs
bombes dans l'indifférence, sans se préoccuper
des points de chute et des victimes. . . Je fais des disques
sans penser aux conséquences. Et puis, j'étais
trop âgé et ce succès a été
trop bref pour qu'il affecte ma vie. Ce n'était
pas comme si ça m'était arrivé quand
j'étais adolescent. Moi, je travaillais depuis
des années, j'ai ressenti ce succès comme
des vacances d'été dans un pays exotique
(sourire). . . Et je n'aurais pas voulu qu'elles
durent plus longtemps. Ce qui m'a alarmé, c'est
que plus tu deviens populaire, plus tu as de contraintes.
Pour la première fois, des gens me disaient de
ne pas mettre tel solo de guitare de Fred Frith ou de
changer un début, une fin. D'un coup, on me désignait
ce qui était requis pour répondre à
un langage spécifique. On pense qu'être reconnu
donne plus de liberté, alors qu'on en a de moins
en moins, comme à l'école.
Ça vous a posé des problèmes de
conscience de gagner votre vie comme musicien ?
Non, au contraire (rires). . . J'ai été
fier de vivre de la musique dès que j'ai quitté
l'école. Mon prof de maths me disait toujours que
si je n'avais pas de bons résultats scolaires,
je n'aurais jamais de boulot et que je reviendrais le
voir pour lui demander de l'aide. Je suis très
fier de ne l'avoir jamais fait (sourire). . .
Faire des disques, est-ce un travail, un plaisir ou
les deux ?
Eh bien (silence). . . C'est difficile à
dire. L'idée n'est pas un plaisir, non. La phase
des idées me plonge dans une inertie complète.
Je n'arrive à rien de bien tant que je n'accepte
pas complètement ce que je suis en train de faire.
Il y a des gens qui peuvent accomplir leur travail même
s'il ne les intéresse pas, car ils ont une technique,
un tour de main professionnel. Je ne peux pas. Lorsque
je ne travaille pas, je suis heureux de ne rien faire.
C'est un sentiment comparable à celui d'une femme
sur la maternité. L'idée d'avoir un bébé
est terrible: "Non, je ne peux pas repasser par ces
épreuves encore une fois !" Mais, bien sûr,
dès le début de la grossesse, le système
hormonal reprend le dessus et cette femme fait en sorte
que tout aille bien. Pour moi, l'effort, c'est de commencer
; ensuite, ça doit être agréable sinon
je ne peux rien faire. Ça signifie peut-être
que je ne suis pas naturellement musicien. Je ne me réveille
pas avec des mélodies plein la tête et l'envie
d'écrire, comme certains.
Les choses ne viennent-elles jamais seules ?
Ça devrait, mais la vie est trop courte pour attendre
gentiment que les choses arrivent d'elles-mêmes
(rires). . . Mais j'ai installé un piano
et une batterie dans mon bureau pour m'encourager. Je
ne peux pas bouger sans qu'ils viennent se rappeler à
moi. Pourtant, je n'y touche pas tous les jours, car j'ai
d'autres centres d'intérêt. La musique m'intéresse
aussi en tant que consommateur, j'adore écouter
les disques des autres. C'est comme vivre au bord d'une
jolie rivière que tu vois sans arrêt: parfois,
tu plonges pour prendre un bain; d'autres fois, tu préfères
la regarder depuis la rive avec ta vision périphérique.
. . Quand je me mets au boulot, je travaille plutôt
durement et vite, en fait. Mon problème, c'est
que mon esprit change et s'ajuste tous les jours. C'est
épuisant, car un disque existera pour toujours
sur la foi de la décision d'un moment précis,
c'est une sacrée responsabilité. . .
Est-ce à dire que vous craignez la pérennité
d'un disque ?
Lorsque j'ai commencé à enregistrer pour
Rough Trade, je travaillais sur les chansons des autres,
je considérais ça comme un travail à
court terme, je n'attendais rien du futur, pas même
que ces singles soient compilés, comme ça
a été fait. Je faisais des chansons courtes
et pour l'instant présent. Mais d'habitude, je
pense à la postérité, uniquement
parce que ce qu'on a fait par le passé nous hante,
"Pourquoi ai-je donc fait cela ?" (Sourire).
. . Pour la paix de mon esprit, je veux donc m'assurer
que ce que je fais ne me rendra pas nerveux dans le futur.
C'est peut-être pour ça que vos disques
semblent intemporels.
Je comprends ce que vous voulez dire. . . Je n'essaie
pas délibérément de ne pas faire
de disques datés, mais c'est vrai que mon processus
de travail s'étale dans le temps. J'ai parfois
une idée qui met des années et des années
à se concrétiser, elle ne peut donc pas
être marquée par le vent du moment, non.
. .
De même, vous avez toujours
recherché la simplicité, l'épure,
contrairement à la plupart des musiciens des années
70.
Il est suffisamment difficile de clarifier son esprit,
de ne garder que l'important dans un morceau pour qu'il
faille en plus y ajouter des enluminures, des décorations
futiles qui éloignent du point originel. Donc,
j'aime ne garder que les bases, l'air, les paroles. .
. Je n'ai pas de théorie préméditée
qui me limiterait, c'est juste mon mode de fonctionnement.
C'est comme dans le jazz, j'aime l'idée qu'il y
ait cinq instruments dans un quintet, point. Même
si mes disques, ne s'y rattachent pas dans ce sens parce
qu'ils ont plus de texture, j'aime cet aspect direct du
jazz. C'est pour cela que je suis frustré lorsque
je juge mes disques, j'y trouve toujours quelque chose
à changer. Mais je n'en discute qu'avec moi-même,
il y a assez de points sur lesquels polémiquer
sans y mêler d'autres personnes (sourire).
. .
Que reprocheriez-vous à un disque comme Rock
bottom ?
(Silence). . . Je crois que j'ai été
chanceux avec celui-là. Il est venu à une
période où j'ai eu beaucoup de temps pour
y réfléchir, j'ai eu la chance de pouvoir
choisir les musiciens comme je le voulais et d'y travailler
de façon idéale: il faut se sentir bien
avec les gens, ne pas avoir besoin de parler de la musique.
Le travail du compositeur est d'expliquer clairement ce
qu'il veut, ensuite c'est facile à partir du moment
où on a établi une bonne relation avec les
musiciens. Je n'aime pas l'idée d'employer des
musiciens de sessions. Pour moi, un disque, c'est aussi
de la compagnie. Quand tu fais un disque, ou que tu en
écoutes un, tu invites des gens dans ta propre
chambre.
J'ÉTAIS LE BUVEUR
Revenons au passé. On a fait tout un plat de
l'école musicale de Canterbury, qu'en est-il exactement
?
Je ne pourrais pas vous renseigner personnellement (rires).
. . Je ne me souviens pas d'un mouvement particulier.
J'étais à l'école là-bas,
je m'y suis marié et y ai vécu. L'école
où je suis allé n'avait rien de spécial,
il n'y avait pas d'intérêt particulier pour
l'art, et je m'y ennuyais car je n'étais pas très
bon élève. Je ressentais donc une pression
et, d'année en année, je perdais prise.
Etes-vous d'une famille où le succès
scolaire était important ?
Mes parents n'étaient pas particulièrement
vieux jeu mais estimaient que je devais être bon
dans une matière, or il n'y en avait aucune où
j'excellais. . . Pas même la musique. Quand on a
14 ans, chanter La Truite de Schubert n'est pas
particulièrement excitant, la cour de récréation
est plus intéressante (sourire). . . J'écoutais
beaucoup de musique car mon père était pianiste,
c'est lui qui m'a initié au jazz, et c'est devenu
ma raison d'être. Non, pour être honnête,
en relisant mes carnets, je m'aperçois que mon
principal intérêt à cette époque,
c'était les filles. J'en parlais beaucoup dans
mon journal. Ce journal devait être un moyen de
réussir quelque chose par moi-même car je
me sentais un peu perdu. L'école, c'était
comme un entraînement pour quelque chose qui n'était
jamais défini, je ne comprenais pas ce qu'on attendait
de moi ; ce journal, lui, était concret. Je n'avais
aucune idée de ce que je voulais faire plus tard.
Si la scène beat n'était pas apparue au
milieu des sixties et que je ne me sois pas mis à
la batterie, je me demande vraiment ce que j'aurais fait.
Votre jeunesse a-t-elle été marquée
par le sentiment spécial de l'après-guerre
?
C'est possible, je me souviens du rationnement alimentaire
qu'on subissait, et c'est peut-être pour cela que
je suis devenu végétarien car la viande
était rare et étrange (rires). .
. Mes parents ont certainement plus souffert de l'après-guerre
; pour eux, c'était une fausse aube. Ils ne voulaient
plus de guerre, et ça a recommencé immédiatement
(rires). . . D'un autre côté, ils
sentaient que le peuple était respecté pour
la première fois de l'histoire, parce qu'il s'était
battu pour la patrie et qu'on lui reconnaissait donc un
droit à la santé et à l'éducation.
Mes parents étaient assez cultivés mais
ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils vivaient donc,
économiquement parlant, comme la classe ouvrière.
Aviez-vous un sentiment de frustration à vivre
dans une petite ville ?
Il ne faut pas exagérer. J'avais de très
bons amis, comme Hugh Hopper, qui étaient musiciens.
Mais pour se stimuler, on essayait d'économiser
de l'argent pour passer le week-end à Londres,
à dormir par terre chez l'un ou chez l'autre. On
avait trouvé un café dont le juke-box était
plein de disques de Thelonius Monk, ça nous paraissait
incroyable, on trouvait cela vraiment cool. J'avais une
paire de lunettes très noires, comme Ray Charles,
j'avais donc du mal à voir quoi que ce soit de
Londres, mais je me disais qu'en les retirant, je ne pourrais
plus trouver de petites copines cool (rires)...
D'où est née l'idée de faire un
groupe ?
Je crois que l'idée concrète vient de Hugh
Hopper plus que de tout autre. Sans lui, nous serions
restés des lycéens qui s'amusent. C'est
lui qui a pris tous les contacts pour jouer, on répétait
chez lui. Ses pauvres parents. . . Ils étaient
si gentils. Ils avaient une toute petite maison et on
s'installait juste derrière la porte d'entrée.
Personne ne pouvait entrer sans se prendre les pieds dans
la batterie. Et nous, on improvisait, on essayait de jouer
des morceaux de Cecil Taylor ou de Ray Charles. Les parents
de Hugh ne disaient jamais rien sur notre musique, c'est
dire combien ils étaient gentils (rires).
. . Grâce à Hugh, nous avons eu une réputation
de groupe local, mais nous, nous voulions partir à
Londres. S'il y a eu une scène à Canterbury,
c'est vraiment quand les Wild Flowers (premier groupe
de Wyatt, avant Soft Machine) sont devenus Caravan,
eux étaient des gens de Canterbury.
Fin 68, on voit la première photo de quatre
jeunes garçons, Kevin Ayers, Mike Ratledge, Daevid
Allen et vous. C'est le groupe Soft Machine.
Il s'est donc monté autour de ceux qui avaient
quitté Canterbury pour Londres. Lorsqu'on quitte
une petite ville pour une grande, on ne connaît
personne et on reste donc en contact avec ceux qu'on connaissait
avant. Je ne me souviens vraiment plus comment cela a
commencé. Je sais que Daevid Allen, qui était
australien, plus vieux et plus expérimenté,
a été très stimulant. Il préférait
Paris, où il s'était marié et vivait
sur une péniche amarrée au quai d'Orsay.
Il avait des amis musiciens de jazz ou poètes,
comme Brion Gysin. Moi, mes influences venaient du jazz,
mais lui, avec ses amis plus dans le vent, nous a donné
beaucoup d'idées, pour les light-shows par exemple,
ou pour les drogues et compagnie. Les drogues ne m'ont
pas du tout influencé, mais Daevid certainement.
Qui a choisi le nom de groupe, évidemment tiré
du livre de Burroughs ?
Je ne m'en souviens vraiment plus. . . L'un d'entre nous,
mais probablement pas moi (rires). . . Daevid avait
en tout cas assisté à des lectures de Burroughs
à Paris. Et il prenait pas mal de drogues.
On pourrait se demander, à
ce point de l'entretien, si ce qui vous a motivé
pour monter le groupe était le jazz, la drogue
ou les filles. . .
Je me le demande aussi (rires). . . Certainement pas la
drogue en ce qui me concerne, elle me rendait nerveux.
Moi, j'étais le buveur. On peut boire comme un
idiot sans être poursuivi par la police. Déjà
à l'époque, je me tenais à l'écart
de la drogue à cause de cela. En tout cas, je ne
me souviens plus de ce qui nous a poussés à
monter le groupe. Nous étions un peu les gars de
la campagne qui montent à la ville et qui doivent
apprendre plus vite, c'est vrai. Il faut ajouter que ce
qui m'intéressait le plus, c'était de devenir
batteur, apprendre à mieux jouer, réussir
à en vivre.
Sur les vieilles photos, vous avez pourtant l'air assez
intéressé par le look et le glamour de l'époque.
En fait, la maison de disques qui nous a signés
nous a dit "Règle numéro un: si vous
n'êtes pas capables d'écrire un hit, ayez
au moins des habits de scène, vous devez vous changer
pour jouer, avoir un costume." Ils nous ont donc
emmenés acheter des fringues. La seconde règle,
c'était d'avoir des coupes de cheveux. Ils payaient,
on s'exécutait. Cela faisait partie de la routine
lorsqu'on signe un contrat. Ils essaient de vous rendre
présentables. Ça, comme le fait de venir
à Londres, c'était pour échapper
à l'ennui, chercher l'aventure.
Pour des gens qui cherchent à fuir l'ennui,
était-ce un accomplissement d'être dans ce
monde du show-biz, on vous a vus par exemple sur des photos
avec Hendrix. . .
C'est parce qu'il était signé par le même
management que nous. C'était agréable d'être
si près d'un musicien de cette qualité,
ça vous fait réfléchir, Quand même,
côtoyer un batteur aussi fantastique que Mitch Michell...
J'avais du mal à imaginer que le public aille les
voir eux, et viennent aussi nous voir. . . Ça nous
motivait pour bosser la musique, afin de ne pas passer
pour des idiots.
Vous avez accompagné Hendrix en tournée
aux USA, vous sentiez-vous proche du rock'n'roll circus
?
Lui-même ne se sentait pas dedans. Quand je disais
que la maison de disques nous imposait de beaux vêtements,
que les managements organisaient des fêtes, ça
c'est le rock'nroll circus et sa routine: ils vous présentent
sous un certain angle. Mais on peut très bien prendre
tout ça avec détachement. On est heureux
que le public nous demande, et flattés, on apprécie
les intentions, donc on marche avec Ia maison de disques;
mais sans pour autant être enfermés dans
son système. Habituellement, les gens de la qualité
d'Hendrix sont des jazzmen, et donc, être dans la
même pièce que lui, sur la même tournée,
était très stimulant.
Que trouviez-vous de plus chez les jazzmen, comme Ornette
Coleman, que chez les Beatles ou les Stones par exemple
?
Je ne sais pas. Nous n'avons jamais pensé jouer
du rock. Probablement du fait que notre musique n'entrait
pas dans un format déjà existant, nous nous
sentions plus près de gens comme Coleman qui avait
en quelque sorte inventé une musique, même
s'il était très modeste et sympathique.
On ne savait pas comment jouer de la pop. . . Du jazz,
nous avions pris le plaisir physique de jouer de notre
instrument et de le travailler. La pop n'offrait pas assez
d'espace ouvert à l'improvisation. D'autant que,
quand tu fais un hit, tu dois toujours le jouer de la
même façon et il n'était pas question
que nous jouions un morceau deux fois pareil.
Etiez-vous attirés par l'idée d'avant-garde
dont on gratifiait Soft Machine ?
Je ne peux pas parler au nom des autres, mais pour ce
qui me concerne, le mot avant-garde me paraît un
qualificatif rétrospectif. Comment dire que quelque
chose est avant-garde au moment où il a lieu ?
Contrairement à tous les groupes de l'époque,
plus ou moins psychédéliques, Soft Machine
improvisait sur de vraies pop-songs. . .
Ça me paraît être une définition
juste. Probablement parce qu'à cette époque,
on était des buveurs et pas des fumeurs (rires).
. . La bière au lieu du haschich, ça nous
a éloignés du psychédélisme.
Par contre, notre public devenait de plus en plus snob,
et ça a influencé ce que j'ai fait par la
suite. S'il y avait quelque chose que je n'appréciais
pas dans la musique classique moderne qu'écoutait
mon père, c'était bien cette atmosphère
snobinarde. Et je ne voulais pas la voir réapparaître
dans le rock. Ce qui est bien dans le rock, c'est son
côté démocratique, tout le monde peut
en faire, tout le monde peut en écouter. Un constat
presque politique s'impose: le rock est une musique à
laquelle n'importe qui peut prendre part. Je n'aimais
pas l'idée d'une musique rock élitiste,
ce n'est pas avant-garde du tout; au contraire, c'est
un concept très démodé. En même
temps, je crois avoir été un peu dur envers
le public, j'ai rencontré depuis des gens qui aimaient
notre musique très simplement et qui étaient
très gentils. J'avais été trop dur
envers ces pauvres diables que je n'avais jamais rencontrés
(sourire). . . Il faut dire qu'il fait noir lorsqu'on
joue, on ne peut pas voir les gens (rires). . .
Ils étaient peut-être charmés par
quelque chose dont vous jouiez depuis vos débuts
: la pataphysique. Votre tout premier slogan publicitaire
était "Nourririez-vous votre fille à
la Machine Molle ?"
Cet intérêt est venu du premier signe de
sympathie que nous ayons reçu : un boulot dans
le sud de la France. Et le Sud, en été,
c'est Paris (rires). . . Qu'est-ce que je raconte,
c'est venu bien avant, lorsqu'on nous a demandé
de faire la musique pour une pièce d' Alfred Jarry
au festival d'Edimbourg. Nous nous sommes donc intéressés
au propos de la pièce et on a trouvé ça
magnifique, même dans la traduction anglaise. C'était
la première fois qu'on nous laissait être
nous-mêmes, au lieu d'être calibrés
et dirigés par le management. Nous nous sommes
reconnus dans cette attitude, on avait trouvé le
moyen d'être en confiance pour jouer sans nous soucier
d'une étiquette à coller sur notre musique.
Comment vous êtes-vous reconnus dans la pataphysique
?
Dans mon esprit, c'érait une extension de ce que
mon père m'avait dit, plein d'admiration, des dadaïstes.
II était incroyablement enthousiaste sur la musique
de Satie et son attitude. Et puis, la pataphysique me
faisait rire. Dieu, laissez-moi réfléchir
(silence). . . Je suppose que j'étais déjà
un pataphysicien stalinien puisque j'adhérais à
la définition de la pataphysique que quiconque
me donnait et que ça devenait la définition
du jour. J'acceptais totalement l'autorité de quiconque
se disant pataphysicien pour ce qu'elle signifiait. Il
me semblait que personne ne savait ce qu'était
la pataphysique et qu'on pouvait l'inventer à l'intérieur
de ce non-dit.
Voulez-vous dire que ce n'était qu'une marque
?
Non. Simplement, on se sentait à l'aise avec l'attitude,
les idées et l'imagerie que nous avons découvertes.
Et puisque notre préoccupation principale était
l'écriture musicale, je ne crois pas que nous puissions
donc détenir quelque autorité que ce soit
sur ce sujet. Il faudrait demander à des gens plus
qualifiés. A ceux qui nous ont donné un
certificat, par exemple. Il est possible qu'ils aient
eu des raisons complètement ironiques pour décréter
que nous étions un groupe pataphysicien. Et je
les en remercie. Mais personne n'a jamais pu expliquer
le pourquoi, et on ne va certainement pas le faire maintenant
(rires). . .
Comment avez-vous reçu l'ordre
de la Grande Gidouille, le diplôme du Collège
de pataphysique ?
Tout ce que je sais, on nous l'a dit après, c'est
qu'un très vieux et très important pataphysicien
qui ne pouvait plus marcher, a été amené
à un de nos concerts. On lui avait décrit
notre musique comme la plus ridicule imaginable et affirmé
que s'il avait besoin d'un orchestre officiel, nous étions
celui qu'il fallait (rires). . . II nous a écoutés
vingt minutes, "Oui, c'est bon", avant qu'on
ne Ie ramène chez lui aussi vite que possible.
C'est ainsi qu'il a décrété que nous
étions adéquats, nous et personne d'autre
(rires). . . Nous avions donc le droit officiel
d'ouvrir la parade officielle de pataphysique chaque fois
qu'elle était appelée à défiler.
Ça n'arrivait jamais (rires). . . Mais ça
nous a valu l'ordre de la Grande Gidouille.
Qui étaient ces gens du Collège de pataphysique,
des enseignants loufoques ?
Je ne sais vraiment pas. C'était des gens qui présentaient
bien, ils ne venaient pas à nous en disant "Hello,
je suis pataphysicien" mais en prononçant
quelque chose de très bizarre. C'est seulement
après coup qu'on réalisait que la phrase
n'avait pas de sens. "Ah oui, il doit être
du Collège de pataphysique" (rires).
. .
On trouvait une part d'absurdité et d'ironie
dans Soft Machine, alors que le groupe était pris
au sérieux. N'était-ce pas frustrant ?
Sur la fin, c'est certain, nous n'avions plus d'identité
collective. Les autres ne voyaient pas la même chose
que moi dans le groupe. J'étais plus touché
par l'absurdité comme élément libérateur
que les autres. . . C'est pour cela qu'après quelques
années, ils ont cherché quelqu'un de plus
sérieux. Moi, je pense que l'absurdité,
c'est très très sérieux.
Au vu de vos carrières solo, on se rend compte
qu'il n'y avait que vous et Kevin Ayers pour jouer sur
l'humour et la simplicité.
J'étais deux personnes. Le batteur, mais aussi
un chanteur. Et la direction dans laquelle j'allais en
tant que batteur était différente de celle
où le chanteur voulait aller. Tant que ma priorité
était la batterie, le contexte convenait. Mais
je développais de plus en plus de petits moments
de simplicité et de clarté contre le barrage
des effets compliqués: c'était le chanteur
qui grandissait en moi. Et il est venu à la surface
plus tard. . .
Le chanteur était-il frustré par le batteur
?
Pas vraiment. Il était comme un petit frère
attendant son tour. Je ne voulais pas vraiment devenir
chanteur. . . La batterie est un instrument atonal qui
produit des rythmes et une texture, une énergie
que j'appréciais dans le jazz. Mais en tant que
consommateur de musique, ce qui me hantait, c'était
de petits fragments de mélodie qui se stockaient
dans mon esprit et n'avaient pas l'opportunité
de se développer dans ce contexte. J'avais donc
besoin de trouver un contexte, c'est tout. Ensuite, ça
a été un processus lent. Mais, cette analyse
est faite a posteriori. De plus, je ne veux pas porter
de jugement sur les différences qui existaient
au sein du groupe: qui avait fait le bon choix, qui avait
fait le mauvais ? C'est trop embarrassant. Je peux juste
dire que j'étais de moins en moins à l'aise.
Vous êtes gêné parce que c'est vous
qui avez fait le bon choix, au regard de l'histoire de
la pop.
Je ne voyais pas de voie qui conduirait directement à
la joie et l'illumination. Et je ne voulais plus consacrer
ma vie à être dans une machine de plus en
plus efficace. Les autres me faisaient me sentir mal à
l'aise, pour une simple raison: la plupart du temps, j'étais
un imbécile bourré. C'était loin
d'être amusant, et même pénible, lorsqu'on
essayait de travailler avec moi, pas parce que j'étais
lourdingue, mais à cause de mon indiscipline (silence).
. . Sans fierté, je dirais que je les ai quittés,
mais il me semble que la vérité est que
je ne les aurais pas quittés s'ils m'avaient demandé
de rester. Ils recherchaient quelqu'un de plus professionnel,
j'étais considéré comme un amateur
fini: j'étais devenu de plus en plus embarrassant
pour eux. . .
Peut-être viviez-vous plus dans l'esprit post-soixante-huitard,
flower-power ?
J'étais dans un état d'esprit qui datait
d'avant cela. Flower-power, ça me fait penser à
des étudiants californiens, et je ne me trouvais
aucune affinité culturelle avec cette ambiance.
Si j'arrive à clarifier mes idées de l'intérieur,
je dirais que je me sentais plus redevable à l'esprit
dada et à la pataphysique. Je n'arrive pas à
replacer ma trajectoire personnelle dans un contexte social.
Je ne me sentais pas partie prenante du mouvement hippie
ou d'autre chose. J'étais avec des gens. . . Encore
une fois, il me fallait trouver un contexte différent
du groupe et c'était difficile car j'avais mis
beaucoup de mon identité dans Soft Machine et ça
ne collait plus. Je devais partir et recommencer autre
chose. C'était comme un divorce et j'avais peur
des problèmes matériels, il fallait que
je me débrouille seul pour trouver des contacts,
des billets d'avion, de l'argent pour des micros ou une
batterie. . .
Viviez-vous plus comme une pop-star ou comme un père
de famille ?
Laissez-moi réfléchir... Dans les sixties,
j'étais marié à Pamela et nous avons
eu un fils, mais à cause de la vie de groupe, des
voyages, j'étais un père et un mari inefficace,
comme un marin. . .
Voulez-vous dire que vous aviez une fille dans chaque
ville ?
Pas nécessairement. Simplement, je n'avais pas
le sens des responsabilités que requiert un enfant.
Tout le travail incombait à la maman. Ce n'est
pas exactement la réponse à la question,
mais j'essaie de me souvenir (silence). . . Je
me rappelle que j'ai cessé de voyager en taxi pour
reprendre le bus, si c'est ça la différence
entre une pop-star et un père de famille, alors
(rires). . .
REJOINDRE UN PARTI MOCHE ET HORRIBLE
Aviez-vous déjà des préoccupations
politiques ?
Je crois que j'en ai toujours eu, mais jusqu'à
la fin des sixties, je pensais que le monde entier les
partageait et qu'il n'était donc pas nécessaire
de les exprimer ou de se battre pour elles. C'est seulement
lorsqu'une espèce de néo-conservatisme démodé
a pointé son nez, plus tard, que j'ai décidé
de ne pas le cautionner par le silence. Je suis donc devenu
actif pour rester moi-même. Avant, il y avait un
consensus car la droite avait été discréditée
par la Seconde Guerre mondiale, qui était la crise
ultime de la droite en quelque sorte. Et là, d'un
coup, la droite avait survécu, et elle se portait
même très bien, merci pour elle (rires).
. . Mais, je n'attends pas des autres, des groupes de
rock, qu'ils aient des prises de position politiques.
Je sais que c'est suffisamment dur de faire les concerts,
de vivre sa vie. Je connais des gens très charmants
mais qui ne peuvent pas avoir de préoccupations
politiques, ils vivent, travaillent et essaient de faire
le bon choix lorsqu'une alternative se présente.
Je l'accepte tout à fait. Moi, j'ai été
de plus en plus stimulé par l'analyse politique.
N'aviez-vous pas d'ennemis dans les sixties, contrairement
aux étudiants de 68 ?
Je pensais que les ennemis avaient perdu (rires)...
Quant à 68...
En allant à Paris, ou en Allemagne, nous étions
plongés dans un drame que nous ne pouvions pas
comprendre. Et cependant, nos sympathies étaient
très claires: quand tu vois un gosse frappé
par un policier français, tu es du côté
de l'étudiant, d'un point de vue purement émotionnel.
Il me semblait indéniable que lorsqu'elle deviendrait
adulte, cette génération ne permettrait
plus que la police ait un tel comportement. Et puis, je
pensais qu'elle avait été traumatisée
par la Seconde Guerre mondiale que nous avions en quelque
sorte ratée. Notre incompréhension venait
donc d'une différence d'expériences. Je
n'ai découvert les ramifications internationales
du mouvement de 68 que plus tard. Je n'étais pas
au même point de réflexion politique que
les activistes de l'époque.
Votre conscience politique est-elle apparue grâce
à la lecture ?
Au départ, c'est venu de voir des policiers frapper
des étudiants (rires). . .
Et, plus tard. . . Quand tu es fan de jazz, les aristocrates
de ta famille culturelle sont noirs, donc d'origine africaine.
Je me sentais plus proche d'un jazzman noir que d'un Anglais
me disant d'être fidèle à ma race.
"Pour qui te prends-tu pour m'interdire d'écouter
Coltrane, merde, quand tu feras des disques aussi bons
que les siens, reviens me voir" (rires). .
.
Etiez-vous féru d'anglicité ou cela vous
énervait-il ?
Oui. Ce qui m'énerve avec l'anglicité, c'est
son double langage. Qui se résume dans cette phrase:
nous sommes si modestes, c'est ce qui nous rend meilleurs
que le reste du monde. Et que pensent les autres des Anglais
? Que ce sont des gens charmants, polis; d'accord, ils
ont bien essayé de conquérir le monde, mais
ce n'est rien. C'est cette image de gentils gars qui jouent
au cricket qui serait celle du peuple le plus impérialiste
et le plus mégalomane de toute l'histoire ? Impossible
de songer à cela et de rester sain d'esprit. Peut-être
que grâce à mon père - les compositeurs
qu'il écoutait étaient russes, français,
américains - ou la peinture que j'aimais - qui
était influencée par la sculpture africaine
ou par les estampes japonaises -, grâce à
tout cela, donc, j'ai pris conscience qu'il y avait de
l'inventivité et de la stimulation dans le monde
entier.
Est-ce ce qui vous a poussé
à écouter des radios du monde en ondes courtes
?
Ça, c'était plutôt dans les seventies,
pour avoir plusieurs éclairages sur ies événements
et la vie. Car l'un des aspects de cet étrange
narcissisme anglais, c'est qu'il était soi-disant
suffisant d'écouter la BBC, puisque contrairement
à la radio russe, elle donnait tous les points
de vue, passait toutes sortes de musiques, etc. Mais lorsqu'on
prétend qu'il n'y a pas lavage de cerveau, c'est
en fait là qu'il y en a. C'est pour ça que
je recherchais des points de vue extérieurs, en
particulier de personnes dont on me disait qu'elles étaient
le diable. Vous, Anglais, me dites qui est l'ennemi et
que notre Premier ministre et son grand-père Shakespeare
sont Dieu; comme je ne suis pas d'accord, je ne suis donc
pas convaincu que ceux que vous me désignez comme
l'ennemi le soient. C'est une attitude dont les Américains
semblent avoir hérité, tout comme ils ont
hérité de notre langue. Certains les décrivent
comme ayant des besoins globaux mais une insularité
spirituelle. Ils ont donc comme image d'eux-mêmes
celle d'un petit village tranquille qui veut être
en paix avec les autres, alors qu'en fait, ils ennuient
tout le monde. Ils ne veulent pas prendre la responsabilité
de ce qu'ils ont fait par le passé.
C'est ce que vous avez un jour décrit comme
l'United State of Amnesia. . .
Oui. Il est difficile de croire quelqu'un qui va partout
dans le monde pour défendre les droits de l'homme
alors qu'il vient d'un pays dont l'existence même
est basée sur l'extermination des populations indigènes.
La bataille des Américains contre Ies Indiens était
plus vaste et plus réussie que ce que les Nazis
ont fait subir au peuple juif, par exemple. A l'évidence,
tous les habitants d'un continent ont été
exterminés ou sont lessivés, ce ne sont
plus que de tristes alcooliques parqués dans des
réserves. Pardon, je sais qu'il y a aussi un pourcentage
d'Indiens forts et actifs qui travaillent, mais quand
même, ils se sont fait entuber sur une échelle
difficile à imaginer. Je trouve donc qu'il faut
aux Américains une sacrée dose d'amnésie
pour prêcher au monde entier la bonne manière
de faire ou de prospérer après de telles
actions. Ils ont pris cette habitude de se voiler la face
et la conscience avec les Indiens, et puis le procédé
s'est répété. Quant à nous,
les Anglais. . . La principale chose que nous ayons appris
à nous cacher sur l'Empire, c'est bien que la fonction
primaire d'un empire est de sucer la richesse des victimes
pour enrichir celui qui ponctionne, alors qu'on présentait
ça comme une expansion de la civilisation chrétienne,
du commerce libre, de l'éducation. . . Ça
ne me dérangerait pas si on avait admis la réalité.
Il y avait eu des empires avant, ils disaient "Nous
sommes les plus forts et les plus grossiers et on veut
vaincre les autres pour se sentir mieux." Au moins,
c'est honnête, et c'est ce qui nous a manqué.
Est-ce pour être plus actif que vous avez rejoint
le Parti communiste anglais ?
J'ai mis du temps. Durant les seventies, j'ai voulu rejoindre
des gens d'une classe qui s'éduque en permanence.
Ma femme et moi étions sans cesse à la recherche
de livres, et il était plus stimulant d'être
dans un milieu où les livres circulent tout le
temps. Le Parti communiste semblait un bon vecteur, car
en Angleterre il n'a jamais eu ni la crédibilité
ni la taille de ceux de France ou d'Italie, pour d'évidentes
raisons historiques: chez vous, la résistance passait
par le communisme, ici, elle s'appelait Winston Churchill
(rires). . . Je sentais que j'étais prêt
pour rejoindre une organisation politique qui était
aussi impopulaire et incomprise que pouvait l'être
l'avant-garde dans le milieu artistique. Vous me demandiez
ce que je pensais de l'avant-garde, comment la définir.
Si elle a une valeur, c'est bien de voir de la beauté
là où les gens voient de l'horreur. Dada
nous a appris qu'il n'y a pas de choses horribles. Donc,
ça ne me posait pas de problème de rejoindre
un parti qu'on disait moche et horrible. j'avais assez
de confiance en moi pour rejoindre un groupe très
impopulaire parce que j'avais besoin d'une atmosphère
d'analyse, d'être au contact de gens qui lisaient
plus que moi.
Les communistes anglais sont-ils plutôt des intellectuels
que des ouvriers ?
Le président de ma section était plombier,
et il m'a fait énormément réfléchir.
Je l'aimais beaucoup, c'était un plombier très
éduqué et posé. L'idée que
les intellectuels puissent être coupés du
monde des travailleurs ne m'a donc jamais effleuré.
Etre communiste en Angleterre m'a apporté un énorme
courage. Dans le monde du rock ou des arts, les gens considérés
comme dangereux sont finalement assez bien traités.
On t'adore même quand tu es un rocker dangereux,
donc c'est que tu ne l'es pas vraiment. Par contre, si
tu es communiste ici, on te descend en flèche et
on te marginalise, on te traite comme une merde. En un
sens, le vrai courage est là et pas chez les rockers
rebelles qui jouent juste un rôle. Dans ma section,
j'ai rencontré des gens vraiment courageux qui
ne seront jamais connus ni millionnaires. . .
Et pourquoi avez-vous quitté le parti ?
C'est comme la question sur mon départ du groupe.
. . Est-il tombé ou l'a-t-on poussé ? (rires).
. . je suis parti parce qu'il me semblait ne pas retrouver
ce courage des gens de la base parmi les dirigeants. Ils
paraissaient uniquement préoccupés par les
attaques incessantes de la presse et déterminés
à ne garder du communisme que le nom. Pour cela,
ils devenaient plus amicaux envers nos ennemis à
une époque où ça ne m'impressionnait
plus du tout.
Ils devenaient professionnels ?
Oui. Ma femme a toujours été plutôt
anarchiste, et elle me disait "Bien sûr, Robert,
la merde finit toujours par remonter à la surface"
(rires). . . j'ai toujours été un
léniniste romantique. . .
Y avait-il des polémiques sur le fait d'être
plutôt léniniste ou trotskiste ?
On ne peut pas discuter avec un trotskiste (rires).
. . je n'ai jamais été hostile aux trotskistes,
simplement ils m'énervaient d'avoir parcouru la
moitié du chemin pour faire ensuite le mauvais
choix politique (rires). . .
Et vous, n'avez-vous jamais pensé avoir fait
le mauvais choix ?
La raison pour laquelle je n'ai jamais été
attiré par le trotskisme, c'est qu'il ne défend
que des théories. Il n'existe pas un seul pays
trotskiste, pas même une petite province italienne,
ce n'est pas une réalité. Les journaux trotskistes
m'ont parfois fait réfléchir, je possède
une histoire trotskiste de la Révolution russe
qui est merveilleuse, mais cette doctrine a une caractéristique
commune avec le christianisme qui me gêne beaucoup.
Celle qui consiste à dire que ses héros
ont été crucifiés. Donc, forcément,
le monde moderne ne peut rien reprocher aux trotskistes,
ils ont une espèce de virginité, de pureté
qui leur donne le droit de critiquer n'importe quoi dans
le monde.
Justement, ce caractère utopique ne vous a-t-il
jamais attiré ?
Vous soulevez un point important. . . Pourquoi ai-je
choisi le Parti communiste ? Cette décision me
paraît toujours évasive et inconsciente.
Les conservateurs attaquent tout le monde en bloc sans
différencier les trotskistes des autres, ils attaquent
en bloc ceux qui se réclament des idées
de gauche. Leurs campagnes de haine sont basées
sur une critique des pays communistes. Les trotskistes
sont assez heureux de s'associer à ces attaques
contre l'URSS ou d'autres. Donc si la droite ne fait pas
de différence entre les courants du socialisme,
moi j'en vois. Et je n'ai pas ce côté artiste
utopique. Je répète que je ne suis pas certain
d'être d'abord artiste, d'être motivé
par l'aboutissement de satisfactions artistiques. Je dirais
modestement que je voulais me dissocier de la machine
à penser conservatrice, uniquement pour préserver
ma santé mentale. C'est presque psychologique,
je me sentais insulté et désorienté
par ce consensus créé par les conservateurs
alors qu'ils prétendent avoir fondé une
communauté vibrante et pluraliste. J'ai plutôt
l'impression qu'ils ont une réponse uniformisée
pour tout ce qui peut arriver dans le monde. C'était
urgent de m'extirper de ce consensus.
Quand vous avez quitté le parti, il y a quelques
années, avez-vous trouvé autre chose pour
remplir votre vie ?
D'abord, je n'ai pas le sentiment d'avoir perdu ce que
j'ai retiré de cette expérience. D'une certaine
manière, j'ai quand même perdu mon éducation
de classe, et donc, je me retrouve au point où
j'en étais dans les années 70 : ma femme
et moi sommes sans arrêt à la recherche de
livres (rires)...
Avez-vous parfois regretté de n'avoir pas un média
plus important que le disque pour exposer votre point
de vue politique ?
Ça va vous paraître étrange, mais
je ne considère pas que toucher un public soit
primordial. Je dois le faire avec mes disques parce que
c'est mon boulot, mais je ne me sens pas une âme
de missionnaire. Donc, je me partage entre le disque,
qui doit nécessairement être public, et discuter,
par exemple, de livres avec ma femme, ce qui est tout
à fait privé. Le travail que je fais, c'est
pour rester intègre et sain. Je serais désespéré
d'être enrôlé dans une direction contraire,
je ne suis pas un rebelle et je veux rester au contact
des gens.
Vous avez d'ailleurs souvent eu des affinités
avec des chanteurs engagés.
Oui, en particulier, j'ai été très
heureux de rencontrer Jerry Dammers (ex-chanteur des
Specials) et de l'aider à faire ce disque
au profit de la Namibie. Je ne sais pas pourquoi on a
mis mon nom sur la pochette du disque parce qu'il y avait
six autres chanteurs et la chanson était de Dammers
(sourire). . . C'était vraiment une rencontre
enrichissante car il est plus homme de terrain que moi.
Etant bloqué sur une chaise roulante, je ne peux
pas aller dans la rue. . . Lui menait une action quotidienne
dans les rues de Coventry. J'ai été particulièrement
impressionné par les groupes sur le label de ska
Two Tones. Je ne suis pas l'actualité du rock,
ce n'est pas la musique qui m'intéresse, encore
une fois parce que je la trouve trop cloisonnée,
mais j'aime beaucoup certains musiciens de rock. Je connais
l'acid-test, qu'est-ce que je raconte ? (Rires).
. . Donc, le test qui détermine mes choix, c'est
quand je sens qu'une personne est attaquée. Si
je lis par exemple une critique de cette Irlandaise rasée,
oui, Sinéad O'Connor, alors je serai à ses
côtés. Voilà le test. C'est ainsi
que j'estime certains musiciens, ou quand je lis des interviews
de groupes irlandais punks comme Stiff Little Fingers
ou That Petrol Emotion. J'apprécie leur attitude,
même si je n'aime pas forcément la musique,
elle me paraît plus sérieuse que celle de
Johnny Rotten. J'aime les gens qui ont une attitude vraiment
courageuse et la mettent au service d'une cause qui le
mérite.
Vous n'avez pas mentionné Billy Bragg, qui est
pourtant le plus engagé.
Bien sûr, je l'aime beaucoup. Pour ses chansons,
mais pas uniquement. Récemment, il a fait une émission
de télé avec un DJ de la BBC. C'était
un reportage, avec juste un magnétophone et un
caméraman, sur les mines d'or en Amérique
du Sud. Ils observaient le fonctionnement de ces vieilles
exploitations coloniales et rencontraient les gens sur
place. Ils enregistraient de la musique locale et Billy
chantait ses chansons. C'était merveilleux, c'était
un reportage qu'un professionnel n'aurait jamais fait.
L'Angleterre manque de Billy Bragg, elle n'a pas cette
tradition de chanteurs engagés qui s'accompagnent
à la guitare et qu'on trouve ailleurs, ne serait-ce
qu'en Amérique.
Comme Billy Bragg, êtes-vous motivé par
la rage ?
Non, je dirais que ma motivation première est presque
l'exact contraire : quand, par exemple, on me dit de haïr
les Cubains, ça me donne envie de chanter une belle
chanson cubaine. Je n'accepte pas qu'on me dise de détester
des gens. Je ne suis jamais allé à Cuba,
mais, par pitié, ne me dites pas de haïr ses
habitants; quels qu'ils soient, vos motivations pour les
détester puent, je le sais. Je fonctionne donc
plutôt sur le refus de la haine. Et si ça
passe dans mes chansons, comme vous le sous-entendiez,
j'en suis ravi. Je me souviens bien de l'exemple des Namibiens.
On disait "Ce sont des noirs - manipulés par
des terroristes cubains de surcroît -, ils ne peuvent
donc pas se prendre en charge, ce ne sont que les poupées
des Russes." Et je les ai rencontrés, ce sont
des gens si bons, si modestes, excellents travailleurs
et accueillants. Et on ne voudrait pas les laisser gouverner
leur propre pays ? Quelle insulte que d'entendre des prétendus
experts dire qu'ils étaient manipulés.
JE CASSE DES OBJETS
En vieillissant, n'avez-vous pas envie de vous occuper
un peu moins des autres et plus de vous ?
(Rires). . . La plupart du temps, c'est ce que
je fais. Comparé à la majorité des
gens que je connais, je suis assez paresseux, assez autocomplaisant,
et mon penchant naturel tendrait à l'hédonisme.
Je me suis retrouvé dans une guerre des nerfs,
mais je ne suis pas un combattant né. J'aime mon
petit confort douillet (silence). . . Ma seule
contrainte en vieillissant, c'est de me montrer de plus
en plus prudent dans mes actions. Je dois réfléchir
trois fois au lieu d'une seule, ou de pas du tout (rires).
. . L'âge en lui-même ne m'effraie pas: plus
tu es vieux, plus tu as vécu, donc plus tu as de
souvenirs, c'est une évidence. Par contre, physiquement,
l'âge est un problème. Cette déchirure
musculaire à la poitrine que j'ai eue avant-hier,
ça peut toucher n'importe qui, mais c'est le genre
d'accident qui m'arrive de plus en plus fréquemment.
. . C'est un rappel constant que je ne suis plus aussi
résistant qu'avant. . . Ce doit être un peu
effrayant pour ma femme (silence). . . En vieillissant,
mon corps ne répond plus comme je le voudrais.
. .
Voulez-vous sous-entendre que vous avez mal vécu
votre accident physique ?
Mon accident originel ? Au début, oui, car je suis
resté un an à l'hôpital et j'étais
assailli par toutes sortes de pensées, sauf les
questions pragmatiques du genre "Comment payer mon
loyer ?". Et puis, à cause de mes limitations
physiques, je devais me concentrer profondément
sur la moindre petite chose. Ça a été
un problème pour travailler, je devais faire de
nombreux efforts, puis abandonner (silence). .
. Peut-être avais-je besoin de la discipline que
j'ai acquise en devenant paraplégique. . .
Etiez-vous enragé contre vous-même à
cause des excès qui ont conduit à cet accident
?
(Silence). . . J'aurais pu atterrir sur (silence).
. . Vu comment je m'en suis sorti, je crois que j'ai eu
de la chance. C'était plus un changement dramatique
qu'un désastre. L'hôpital où j'étais
soigné était très bon. Et lorsque
j'en suis sorti pour enregistrer, les amis avec qui je
travaillais avant étaient toujours là. Quand
vos amis disparaissent, là c'est très dur.
. .
Auriez-vous un fond chrétien pour accepter ainsi
la fatalité ?
Je pense vraiment que ça aurait pu être
pire. Dans le lit voisin du mien, il y avait un ouvrier
du bâtiment qui était tombé d'un échafaudage.
Son syndicat lui avait obtenu une bonne pension car l'échafaudage
était mal fixé, il n'avait pas à
s'inquiéter pour l'argent et on lui avait même
trouvé un boulot dans un bureau. Mais ça
l'a déprimé, car c'était un travailleur
physique et d'extérieur; il ne pouvait pas supporter
l'idée d'être enfermé dans un bureau.
Alors que pour moi, l'idée que je ne puisse plus
être batteur et faire de tournées, c'était
presque. . . Rétrospectivement, c'était
le bon moment pour que ça arrive. Plus tôt,
ou plus tard dans ma vie, cet accident m'aurait abattu
mais pas à ce moment-là. C'était
comme s'il n'y avait plus de suite possible à ma
manière de travailler. Il était temps de
changer ma méthode, ça a été
le cas avec cet accident.
Le prix à payer n'était-il pas trop lourd
?
Bien sûr, de par mes limitations physiques, j'ai
un sentiment permanent de frustration. Oui, je casse des
objets par colère, j'écrase des choses quand
je n'arrive pas à atteindre ce que je veux attraper.
Et après, je me sens mieux: c'est un indicateur
de ma frustration physique.
Votre accident est-il arrivé parce que vous faisiez
trop d'excès ?
Oui. Ma vie était un peu disloquée (sourire).
. . Je cherchais continuellement toutes sortes de stimulants.
Il faut être un peu désespéré
pour chercher à s'amuser sans cesse. Aujourd'hui,
j'ai toujours des tendances à l'excès. Cette
blessure à la poitrine que je me suis faite, eh
bien, c'est parce que j'ai picolé comme un Polonais,
que j'ai voulu m'extraire de mon fauteuil et que je n'ai
pas pu me contrôler. Si on ne me surveille pas,
je vais boire sans m'arrêter ou écouter de
la musique à plein volume pendant six ou sept heures
d'affilée jusqu'à ce que les voisins deviennent
fous.
Avez-vous toujours du plaisir à boire ?
Oui (rires). . . C'est bien là qu'est le
problème.
Vous sentez-vous plus sage avec l'âge ?
Je ne sais pas (sourire)... A 5 ans, on se sent
plus sage qu'à 12; à 20, plus qu'à
15 et à 25, on se rend compte qu'on ne l'était
pas à 20. On se sent toujours plus sage. Il faudrait
apprendre de chacune des expériences précédentes
et assimiler. Comme vous pouvez le constater, j'ai du
mal à tirer la leçon du passé, et
même parfois de m'en souvenir. Pour devenir sage,
il faudrait tout retenir et construire sa sagesse sur
cette somme de savoir. On pourrait ainsi contempler les
choses depuis une montagne élevée (sourire).
. .
Votre réputation de gentillesse, de timidité,
vous énerve-t-elle parfois ?
Gentil ? Si ma femme était là, elle éclaterait
de rire (rires). . . Je ne suis pas assez introspectif
pour me connaître vraiment. C'est drôle parce
que j'ai l'habitude d'être considéré
comme la personne raisonnable associée à
des gens très agressifs. Politiquement, mais aussi
parfois musicalement.
Je n'ai jamais vraiment essayé de me défaire
d'une quelconque réputation qu'on me ferait, simplement
parce que je ne crois pas qu'on puisse tracer une ligne
autour de quelqu'un pour l'enfermer dans une définition.
Et je ne suis pas assez détaché de moi-même
pour pouvoir me juger de l'extérieur.
Avez-vous jamais dû faire un choix entre votre
vie privée et votre carrière ?
Je tiens absolument à préserver ma vie
privée. . . Il y a eu, par le passé, des
moments où mon travail a détruit les chances
de succès de ma vie privée. Je ne veux en
aucun cas que ça se reproduise. En termes plus
explicites, disons que j'ai complètement foiré
mon premier mariage par négligence, je ne veux
pas que ça recommence, Aujourd'hui, je comprends
mieux comment je fonctionne, je vois plus clairement ce
que je dois faire, comment le faire et ce que je dois
éviter. Tout va mieux. J'en suis au stade des réglages
de précision. Dans chaque choix qui se présente
- ne serait-ce que l'achat d'un disque de jazz de tel
ou tel artiste -, je deviens plus réfléchi
et plus précis.
Deviendriez-vous plus rationnel sous l'influence de votre
femme ?
Tiens, je l'entends rire à nouveau (rires).
. . Elle a certainement essayé de me rendre plus
pragmatique. Elle croit avoir réussi, et hop, elle
s'aperçoit qu'elle s'est fait avoir. . . Mais j'aimerais
vraiment devenir plus rationnel si ça pouvait la
rendre plus heureuse.
|