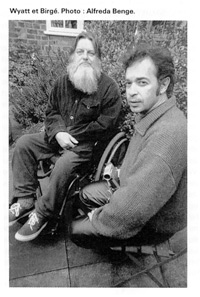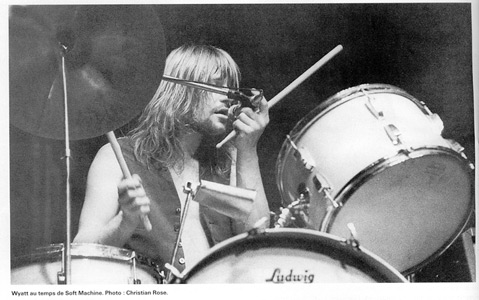| |
|
|
 Le
petit chaperon rouge: rencontre avec Robert Wyatt - Jazz
Magazine - N° 494-495 - juillet-août 1999 Le
petit chaperon rouge: rencontre avec Robert Wyatt - Jazz
Magazine - N° 494-495 - juillet-août 1999
LE PETIT CHAPERON
ROUGE : RENCONTRE AVEC ROBERT WYATT
PAR JEAN-JACQUES BIRGÉ
| |
De Machine Molle (Soft Machine) en Matching
Mole, au bord du jazz comme d'un précipice,
improvisant un autre rock et des chansons d'ailleurs,
il suscite une admiration "culte". Jean-Jacques
Birgé, agitateur sonore d'Un Drame Musical
Instantané, est allé dans le Lincolnshire
retrouver l'ex-batteur, débatteur et (en)chanteur-compositeur.
|
|
Depuis 1969 je voue à Robert Wyatt une admiration
béate qui m'étonne. Tous ceux qui connaissent
ses disques partagent ce sentiment qui tient de l'énigme.
Est-ce pour son inimitable timbre de voix. à la fois
fragile et déterminé, ou bien la rencontre
de mélodies simples avec des improvisateurs souvent
venus du jazz, ou encore les textes qui alternent entre
tendresse, humour absurde et engagement politique ? Il faut
certainement de tout cela pour faire de ce "compositeur
de musique impopulaire" dixit Wyatt, figure légendaire
et homme adorable. Batteur du groupe Soft Machine, il se
signale dans leur troisième disque par le morceau
Moon in June, puis en 1974, après un accident qui
le colle à vie dans une chaise roulante, il impose
son nom avec l'album "Rock Bottom". Avec la complicité
de sa compagne, Alfreda Benge, il va continuer d'enregistrer.
Dernier paru, "EPS", un coffret de cinq disques
qui rassemble des pièces rares ou inédites.
Un film vidéo, Little Red Robin Hood, et un livre,
Faux mouvements, racontent son histoire.
Le numéro spécial de Jazz Magazine consacré
aux Allumés du Jazz lui avait plu parce que s'y côtoyaient
Carla Bley, Grant Green et György Ligeti.
Nous sommes chez lui à Louth, dans le Lincolnshire,
c'est le matin. Dans le bureau dont les fenêtres donnent
sur la rue, un quart de queue, une petite batterie, des
synthés rudimentaires, une trompette de poche, des
livres d'art, des photos de Monk et Picasso à l'oeuvre,
une repro de Paul Klee, des disques presque exclusivement
de jazz. Robert sifflote, une tasse à la main, une
cigarette dans l'autre.
ROBERT WYATT : Hier à table tu parlais des producteurs
qui sont également musiciens. Justement je viens de recevoir
une cassette de Teo Macero, qui a enregistré Monk et Miles
Davis, et j'ai aussi retrouvé de vieux disques de Charles
Mingus où il joue du ténor, magnifique, il aurait pu se
retrouver avec Lee Konitz et Warne Marsh. On entend des
trucs pendant des années et puis soudain ça devient évident.
Macero a travaillé avec Miles Davis pour certains de ses
meilleurs disques, mais le plus extraordinaire c'est cette
cassette dans laquelle il joue. Ce sont vingt minutes d'une
séance de répétition dirigée par Edgar Varèse avec, entre
autres. Eddie Bert, Charles Mingus et Art Farmer, à New
York vers 1954. Et c'est du free jazz. Varèse adorait les
musiciens de jazz, leur son. On l'entend leur donner des
instructions. Teo Macero me dit que ça n'intéressera
personne parce que la bande est mal enregistrée...
Varèse et Mingus dans la même pièce
! En l'entendant il m'est apparu que Mingus, qui était
paradoxalement un compositeur si académique au début,
puis qui avait inventé son propre free jazz avant
le free jazz, aurait pu être directement influencé
par cette séance avec Edgar Varèse. Ce serait
vraiment amusant.
Rompant avec le classicisme, contrairement à Schönberg,
Varèse est le fondateur de la musique contemporaine, qu'elle
soit académique, libertaire ou technoïde. Il a substitué
le concept de "sons organisés" à celui de musique. Il composa
la première pièce pour percussion seule de l'histoire de
la musique occidentale, et fut le premier à mélanger une
bande magnétique et un orchestre. Justement à cette époque,
il préparait les Interpolations qu'il allait intégrer à
Déserts, et comparait l'orchestre symphonique à un éléphant
hydropique et le big band de jazz à un tigre. L'année suivante,
Mingus créait les Modernists avec Teo Macero, inaugurant
une nouvelle avant-garde.
|
Comme
une vieille bicyclette
|
JEAN-JACQUES BIRGÉ : Que tes chansons soient sentimentales,
pataphysiciennes ou politiques, elles sont souvent portées
par un souffle romantique.
R. W. : J'ai été très influencé
par mes parents. Je suis né en 1945 et je n'avais
rien d'un adolescent rebelle. Je n'ai jamais essayé
de rompre avec le passé. Le vibraphoniste Cal Tjader
a dit: "Je veux juste participer". J'adorais ce
que j'imaginais avoir été leur vie dans les
années trente. Mon père aimait la musique
du XXe siècle, surtout lyrique. Il était pianiste
amateur et jouait Debussy, Ravel, Britten. Rien ne me semble
jamais atonal. J'ai toujours été habitué
aux nouveaux rythmes, aux nouveaux sons, je suis né
après le dodécaphonisme. Ma musique ne m'a
jamais paru iconoclaste. Je retrouve ce lyrisme autant chez
Alban Berg que chez Duke Ellington. Mon père avait
aussi des disques de Catherine Sauvage et Juliette Greco,
j'entendais beaucoup de chansons populaires à la
maison. Je crois qu'en fait j'ai une idée de la musique
plutôt vieillotte qui remonte au XIXe siècle.
J'aime être transporté par un chaleureux flot
de sons.
J. J. B. : La qualité de ta voix y est aussi
pour quelque chose, en équilibre sur un fil, à
la fois pleine de doutes et volontaire. En plus, tu l'enregistres,
souvent plusieurs fois, en rerecording, donnant l'impression
d'un choeur.
R. W. : J'imagine que je suis sur une vieille bicyclette
et que je dois affronter des camions sur une autoroute.
Entouré par ces géants métalliques
et technologiques, si je me crashe je suis le perdant. Face
à une symphonie ou à Coltrane, je suis très
vulnérable, aussi je dois agir avec une détermination
claire.
J. J. B. : Ta manière de chanter rappelle les
hymnes révolutionnaires, épiques et romantiques.
R. W. : J'envie les religions qui ont mis quelques
siècles à trouver leur voix. On reproche à
l'art communiste d'avoir été si ennuyeux et
conservateur, surtout si on le compare à la cathédrale
de Chartres ou aux messes de Bach. Mais, au début,
la musique religieuse ne devait ressembler qu'à quelques
petites chansons mal foutues. Il a fallu à cet art
des centaines d'années pour prendre sa forme. J'aime
ses manifestations parce qu'elles sont l'expression d'une
aspiration collective. Je m'identifie complètement
à ces aspects de la religion. Ça n'a rien
à voir avec la mystification religieuse qui sème
la confusion et vous empêche de réfléchir
à votre condition. J'ai le sens du sacré même
si je n'ai pas de religion. J'aime faire partie du tumulte
de la collectivité humaine, le célébrer
et y chercher l'inspiration. Du côté de mon
père il y a beaucoup de pasteurs et de missionnaires.
Au début du XIXe, l'un d'entre eux, George Ellidge
- c'est le nom de mon père, Wyatt vient de ma mère
- fut le premier à aller en Nouvelle Finlande, sur
la côte Est du Canada, et dans les archives il est
écrit que ce qui lui manquait en acuité intellectuelle
était compensé par la beauté de son
âme, en d'autres termes: c'était un complet
idiot mais il avait bon coeur ! Mon père était
heureux de savoir qu'un artiste était aussi une personnalité
de grandeur morale, même si ça n'avait pas
de rapport. Quand j'écoute Coltrane c'est encore
mieux de savoir que c'était aussi un type bien.
|
"
Elvin Jones a apporté l'urgence... C'était
plus spectaculaire que tous les concerts de rock.
"
|
|
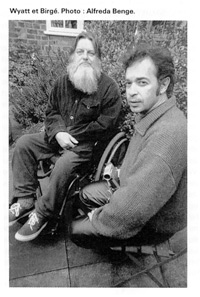
|
J. J. B. : Le fait d'écrire
des paroles te permet aussi d'être plus juste...
R. W. : Une formule simple et banale peut convenir
à une chanson. Les paroles ne sont ni des poèmes
ni des discours. Quand j'ai écrit Amber and the
Amberines ce n'était pas seulement sur l'invasion
de l'île de Grenade par les Etats-Unis : "Nous
avons tous besoin de nous sentir chez nous, personne ne
gagne à se battre seul" ("Everyone needs
to feel at home, nobody wins who fights alone ").
J. J. B. : C'est une phrase emblématique de ton
travail. Tu as aussi l'habitude d'envoyer des messages à
faire passer à d'autres.
R. W. : C'est peut-être à cause de mon
isolement depuis vingt ans. Je ne suis pas un animal social,
je n'aime pas aller dans les pubs, mais j'aime passer le
relais, disséminer. J'adore recopier des cassettes
pour les amis. J'enregistre peu moi-même parce que
d'autres font déjà ce que j'aimerais écouter.
Quand j'entends dans ma tête quelque chose que personne
d'autre n'a fait, je pense devoir l'ajouter à la
contribution générale. Lorsque j'ai fait des
disques tout seul, comme "Old Rottenhat" et "Dondestan",
je n'ai pas eu l'impression de faire des albums solo. Je
les ai faits avec les luthiers, les techniciens, ceux qui
m'ont suggéré tel ou tel air, ça fait
partie d'une histoire collective.
J. J. B. : Il semble que la magie de tes morceaux vienne
entre autres de la manière de faire entrer ta voix
au milieu de l' orchestre de manière extrêmement
déterminée. Il y a une forte charge émotionnelle.
R. W. : C'est une idée qui me plaît
mais c'est inconscient. Quand un morceau commence, je veux
qu'il soit comme la vie. Le sang doit circuler partout.
Le reste peut être flou, mais je fais le point sur
la voix, c'est un centre auquel tout le reste peut se référer.
Les idées de composition ne viennent pas de nulle
part. Je me souviens d'un concert de Coltrane, et d'Elvin
Jones puisque j'étais d'abord batteur. Ce n'est pas
l'innovation polyrythmique qui m'intéressait chez
lui, Tony Williams ou Han Bennink ont été
beaucoup plus loin: il a apporté l'urgence, le 12/8
sous le 4/4 jazz, retardant ensuite un peu, et puis un coup
de cymbale... C'était simple et la section rythmique
jouait seule pendant cinq minutes. C'était plus spectaculaire
que tous les concerts de rock. Coltrane et Eric Dolphy entraient
chacun d'un côté de la scène, aussi
dignes que des employés de pompes funèbres,
ils jouaient India ou quelque chose comme ça ensemble.
Puis Coltrane prenait le solo, on n'entendait plus que lui.
Le solo fini il sortait de scène, de nouveau la section
rythmique, enfin trois minutes plus tard c'était
au tour de Dolphy... J'entends la même chose chez
James Brown"At the Apollo" ou chez Terry Riley,
mais c'est Coltrane qui m'a amené à la transe...
J. J. B. : Un compositeur cherche souvent à retrouver
les émotions fondatrices qu'il a rencontrées
enfant ou adolescent..., Alors que ta voix entre de manière
spectaculaire dans le son, les musiciens qui jouent avec
toi tissent une toile plus souvent qu'ils n'exécutent
des solos, comme par exemple Evan Parker dans "Shleep"
: on n'entend pas un saxophoniste mais plein de petites
notes...
R. W. : Oui, je cherche à ce que la texture
de chaque morceau ou de chaque disque soit spécifique.
Je n'en peux plus de m'entendre, j'ai besoin des autres.
Même Miles Davis s'entourait de bons solistes. J'aime
les instruments. Tant mieux si la voix peut aider la musique.
Dans le morceau de danse sud-africaine de Mongezi Feza j'étais
heureux de simplement doubler la basse avec la main gauche
du piano, de jouer du tom basse et de ne pas chanter. J'aimerais
bien faire autre chose, mais je me dis "merde, j'ai
encore fait un autre disque de Robert Wyatt", je deviens
claustrophobique dans mon corps. Je me fous de tel ou tel
instrument. je suis curieux des personnes, je cherche de
la compagnie.
J. J. B. : Tu chantes souvent pour d'autres musiciens
?
R. W. : Mike Mantler m'appelle de temps en temps.
Carla Bley m'a présenté à lui à
l'époque où nous étions tous chez Virgin.
Il compose une musique très intègre, très
difficile à chanter même si ça a l'air
simple. La voix doit jouer des notes qui ne sont pas portées
par l'harmonie de l'orchestre. C'est souvent un demi-ton
plus loin que là où on s'y attend. Mon préféré
est "The Hapless Child", et les poèmes
de Philippe Soupault dans "Many Have no Speech".
La voix de Jack Bruce, qui est plus enracinée dans
le sol, correspond mieux à son style opératique.
Sinon je suis obligé de refuser la plupart des propositions
que je reçois, ça m'embête, mais ça
m'éloigne trop de mon propre travail. Alfie, ma compagne,
m'a appris à dire "non" ! Je dois bientôt
enregistrer pour la chanteuse Anja Garbarek, la fille de
Jan Garbarek. Elle vient me chercher, je chante ma petite
chanson, elle me ramène, c'est confortable. J'aimerais
chanter plus souvent avec une femme. C'est le yin et le
yang. Comme avec Alfie. J'adore les duos comme Betty Carter
et Ray Charles. J'aurais aimé faire quelque chose
avec Annette Peacock avant qu'elle ne retourne à
Woodstock. En vérité je ne recherche aucune
collaboration.
J. J. B. : Même sur tes propres disques ?
R. W. : Parfois j'ai besoin de renforcer une couleur
particulière, comme lorsque j'ai demandé à
Paul Weller de venir jouer de la guitare électrique
sur Blues in Bob Minor.
J. J. B. : Comment écris-tu la musique ?
R. W. : J'accumule du matériel en jouant pour
le plaisir, au piano ou à la trompette. Je me dis
parfois que ça pourrait faire une chanson. C'est
seulement au bout de six morceaux que je me demande s'il
n'y a pas l'embryon d'un nouveau disque. Je n'écris
pas de manière conventionnelle, j'écris le
nom des notes, A B C D E F G... Je lis mal, j'apprends par
coeur, je dois entendre avant de chanter. L'interprète
que je suis est intimidé par le compositeur qui est
en moi. Le compositeur dit: "Allez Robert, tu peux
le faire", l'interprète répond: "Pourquoi
tu ne demandes pas à quelqu'un d'autre ? ".
Il faut bien que je m'y colle d'abord si je veux que d'autres
jouent dessus ensuite. Comme je n'écris pas, le morceau
doit exister avant qu'ils interviennent.
J. J. B. : Est-ce que tu as enregistré depuis
la sortie de " Shleep " ?
R. W. : J'ai enregistré Hasta Siempre Commandante,
pour Maurizio Camardi, un sax baryton qui est prof à
la Gershwin School de Padoue, dix minutes de Federico Garcia
Lorca sur un double cd espagnol, "De Granada a la Luna",
et avec un collectif italien, C.S.I., qui a enregistré
tout un album avec des chansons de moi ou que j'avais chantées.
C'est mon album préféré, parce que,
pour une fois, même si c'est un" fucking Robert
Wyatt record ", il y a plein de moi que j'aurais pu
être et que je ne suis pas. Le titre est malin: "A
Different You".
|

|
En 1975, j'assistais à la mémorable représentation
que Robert donna avec le groupe Henry Cow au Théâtre
des Champs Élysées. Il y avait là Fred
Frith, Lindsay Cooper, John Greaves, Chris Cutler... Robert
mettait en scène ses entrées vocales avançant
son fauteuil roulant d'un coup de poignet. Il reculait aussitôt
d'un demi-tour de roue, toujours avec la même franchise.
J. J. B. : Tu ne joues plus sur scène depuis 1983.
Improviser ne te manque pas ?
R. W. : J'improvise puisque je ne joue jamais deux
fois la même chose. Quand j'enregistre, ça
marche ou je passe à autre chose. Dans "Shleep"
j'ai composé avec les éléments que
Brian Eno, Evan Parker et moi avions improvisés préalablement.
Je joue d'abord les variations pour trouver le thème
qui y est caché et au mixage j'essaie de rendre tout
ça clair.
J. J. B. : Mais tu ne pratiques plus l'improvisation
libre.
R. W. : Depuis un ou deux ans j'écoute à
nouveau les premiers Cecil Taylor, Ornette Coleman et Don
Cherry, Paul Bley... Au début c'était par
nostalgie, et puis peut-être parce que j'ai retrouvé
Evan Parker que j'avais perdu de vue depuis dix ans. J'ai
réécouté l'Art Ensemble of Chicago,
Steve Lacy, Sunny Murray. Je suis à nouveau fasciné
par l'improvisation collective, mais je ne sais pas si j'en
ferai quelque chose dans mon travail.
A un questionnaire sur le jazz paru dans le numéro
de septembre 1998, Robert Wyatt m'avait répondu:
"Je me sens le rejeton illégitime né
d'une brève rencontre entre Betty Carter et Hans
Eisler dans un motel le long de l'Autoroute 61, et qui a
été abandonné devant l'Orphelinat du
Rock'n Roll"
J. J. B. : Tu te réfères sans cesse à
des jazzmen alors que tu es connu comme musicien de rock.
R. W. : Oui je sais, c'est triste, non ?.. Le rock
anglais s'exporte bien, mais ça ne me transcende
pas. Les chansons de Lennon et McCartney sont géniales,
j'aime bien les groupes dont je connais personnellement
les musiciens, The Jam de Paul Weller qui a un très
bon batteur... En Angleterre tout le monde formait des groupes.
Le rock c'est la musique du gars d'à côté,
mais je veux faire un plus long voyage... Ma raison d'être
vient du jazz. Avant je trouvais la musique merveilleuse
mais je m'intéressais à la peinture, et aux
filles encore plus qu'à n'importe quoi. Je restais
au café à faire ce que je fais ici, boire
et fumer, déconner et me saouler. Entendre Coltrane,
Miles Davis et Ellington a donné un sens à
ma vie.
J. J. B. : Toi-même tu as formé un groupe.
R. W. : Non je les ai rejoints, Soft Machine existait
déjà. Le seul que j'ai formé c'est
Matching Mole et c'était une lourde responsabilité.
Je ne fréquente pas non plus tellement la scène
jazz anglaise. J'y avais des amis mais Mongezi Feza et Gary
Windo sont morts, et Ronnie Scott récemment. "Shleep"
lui est dédié. A Londres on avait toujours
un endroit où aller, et pas seulement pour y jouer.
Je vois souvent la tromboniste Annie Whitehead qui joue
aussi du ska, du reggae, et qui improvise... Les Sud-africains
passaient d'une musique à une autre tout à
fait naturellement, du hard-bop, du free, comme avec Chris
McGregor, mais ils jouaient aussi bien des trucs de danse.
|
"Pourquoi
jouer un truc américain
alors qu'on avait notre propre son ? "
|
J. J. B. : Avec Soft Machine parliez-vous de votre musique
?
R. W. : C'est difficile de me souvenir. Ça
n'a duré que quatre ans. Non. On ne se parlait pas.
J. J. B. : Cela nous apparaissait comme un vrai groupe.
R. W. : Pas socialement. Plutôt un mariage
de raison. Si nous nous étions parlé nous
aurions probablement été en désaccord.
Quand ils m'ont foutu dehors, la musique qu'ils utilisaient
pour la promo à la radio était Moon in
June dans lequel je joue seul tous les instruments,
l'orgue Hammond, le piano, la batterie, le chant. J'étais
très énervé.
J. J. B. : Sais-tu pourquoi ils t'ont viré ?
R. W. : Ils ne me l'ont jamais dit. Je crois que
l'alto Elton Dean n'aimait pas mon jeu. Ironie du sort,
je l'avais fait entrer dans le groupe. Nous jouions très
fort, ça nous assimilait au rock. Elton a commencé
à écrire et il voulait que je joue comme Jack
DeJohnette. Ça devenait un truc de jazz-fusion, ça
ne m'intéressait pas. Je n'écoute pas cette
période de Miles, je préfère le Tony
Williams Lifetime avec Larry Young. J'étais un batteur
arrogant, "je joue comme je joue, tu sais. Il faut
demander à Elton s'il s'en souvient, nous ne sommes
pas fâchés, il était là au mariage
de mon fils. Moi j'avais envie de jouer aussi comme le batteur
d'Otis Redding, même si c'était à des
tempi et dans des mesures différentes. Il n'avait
pas envie de faire ses solos là-dessus. Il pensait
que ça ferait un vrai groupe de jazz avec un autre
batteur. Et puis ils détestaient tous ma façon
de chanter. Moi j'étais heureux d'être juste
un des quatre coins de la table, c'était un honneur
de jouer des compositions aussi intéressantes avec
d'aussi bons musiciens. Cela m'a humilié d'être
viré, mais pourquoi jouer un truc américain
alors qu'on avait notre propre son ? Grâce à
eux j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup. Ça m'a
pris du temps de trouver ma voix. Je n'aurais pas écrit
"Rock Bottom" à vingt ans. Je n'étais
pas assez bouddhiste comme batteur, les solistes attendaient
de moi que je ne sois pas dans le chemin !
Robert Wyatt utilisait sa batterie comme un instrument
complet rythmique, mélodique et structurel. Il aimait
s'y promener.
J. J. B. : Tu joues des claviers, de la guitare, de la
basse, de la trompette, du violon...
R. W. : Je voulais être peintre, et je voulais
utiliser toutes les couleurs...
J. J. B. : Choisir sa palette de timbres est plutôt
l'apanage du compositeur.
R. W. : Plus que de jouer ou de chanter, mon véritable
plaisir était d'organiser la forme de la soirée,
prévoir le moment où les gens pourront bouger
leurs fesses sur leur chaise ou concentrer leur attention.
Si on n'a rien imaginé avant, on se retrouve avec
un solo de guitare au milieu de chaque morceau.
J. J. B. : As-tu joué sur scène d'autres
instruments que de la batterie ?
R. W. : Une fois du piano, complètement improvisé,
avec le groupe Henry Cow. Quand j'étais très
jeune, je jouais de la trompette mais pas dans des conditions
professionnelles, des trucs dans le style de Jelly Roll
Morton ou Bunk Johnson. J'avais toujours une embouchure
dans ma poche.
J. J. B. : À propos d'instrumentation inhabituelle,
Jimi Hendrix a joué de la basse avec toi...
R. W. : J'enregistrais en studio Slow Walkin''Talk,
un morceau qui est devenu plus tard Soup Song. C'est
un boogie-woogie avec des changements de tonalité
vers le haut et le bas. J'avais fait la batterie, l'orgue
Hammond, le piano... Je ne payais pas, Hendrix avait loué
l'ensemble des studios et m'avait offert de m'en servir,
il était très gentil, son trio était
très attentif aux musiciens qui essayaient de faire
quelque chose, c'était une manière de nous
subventionner. C'est la raison pour laquelle Hendrix m'a
proposé de faire la ligne de basse, qu'il a enregistrée
immédiatement, très inventive et totalement
intégrée à ma petite chanson. J'étais
fier, surtout lorsque j'ai réalisé que, bien
que gaucher, il avait utilisé la basse de Noel Reedding.
Hendrix était ambidextre et il se débrouillait
également très bien à la batterie.
Il n'écrivait pas la musique, il expliquait à
Mitch Mitchell ce qu'il voulait en prenant les baguettes,
comme Stevie Wonder la batterie, il jouait l'essentiel...
Je n'avais pas les moyens d'acheter la bande. Le morceau
a été repiqué d'après l'acétate,
c'est un disque en métal, il n'y avait que deux copies...
|
...
Ou Petit Chaperon Rouge?
|
J. J. B. : Penses-tu qu'une chanson puisse influencer
une opinion politique ? R. W. : Pour moi c'est
plutôt l'inverse, la situation politique exerce une
influence décisive sur la musique à tous les
niveaux. Si le musicien est riche ou pauvre et pourquoi,
comment il perçoit la société, comment
il est reçu...
J. J. B. : Un artiste a-t-il un rôle à jouer
dans la société ?
R. W. : À la radio j'ai entendu une émission
sur les mouvements chiliens dans les années 70 avec
Violetta Parra et Victor Jara. Allende les encourageait
à jouer partout, pour les syndicats, pour tous ceux
qui luttaient contre l'exploitation. Hélas, tout
ce que ça a donné c'est que Kissinger a empêché
la General Motors d'envoyer des pièces détachées
pour les automobiles et qu'il a suggéré aux
banquiers de retirer leur argent du Chili. Je ne crois pas
qu'une chanson puisse battre un tank. Pour les Sud-africains,
chanter et danser fait partie de la lutte, l'hymne de l'A.N.C.
a été crucial.
J. J. B. : Les Américains utilisent l'industrie
culturelle à des fins hégémoniques.
R. W. : C'est vrai, c'est comme du temps du christianisme.
Ils prêchent partout dans le monde: " Il n'ya
qu'un seul dieu et son nom est Elvis, chantez en anglais,
prenez des guitares électriques et marchons ensemble!".
C'est ce qui se passe aujourd'hui à Cuba.
J. J. B. : Nous avons une responsabilité en tant
qu'artistes...
R. W. : Oui, derrière les lignes ennemies.
Que la langue anglaise soit dominante est pour moi très
embarrassant. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Je chante
en italien, en espagnol! J'essaie seulement de me préserver
des mauvaises odeurs que dégage la société
occidentale à laquelle j'appartiens.
J. J. B. : Aurais-tu un conseil à donner à
un jeune musicien ?
R. W. : Je ne suis pas un sage. J'ai souvent cru
avoir compris, et tous les dix ans je m'aperçois
que je me suis trompé. J'ai passé ma vie à
faire l'idiot. Une chose dont je suis sûr c'est qu'il
ne faut pas penser en termes de carrière. Il faut
rester soi-même, qu'on soit Bob Dylan ou Lol Coxhill.
Je dirais comme le titre d'un film de Spike Lee: "Do
The Right Thing" ("Fais ce que tu as à
faire").
J. J. B. : Et à ton fils ?
R. W. : "Les filles détestent les garçons
qui se rongent les ongles". "Nettoie la cuvette
des toilettes après toi"... Il a hérité
de moi une sorte de déconnexion d'avec le monde réel,
il est heureusement avec une fille qui sait comment faire
avec les choses pratiques.
J. J. B. : Comme Alfie avec toi ?
R. W. : Elle m'a sauvé la vie. Elle a une
certaine ténacité qui m'empêche de sombrer
dans un rêve dont je me réveillerais cinq ans
plus tard. Elle s'est occupée qu'on perçoive
des droits sur les cd (on n'a rien touché sur les
33-tours), elle a tourné une vidéo, elle écrit
des paroles, des poèmes, elle est pleine de ressources,
on passe du bon temps ensemble. Nous aimons les mêmes
comédies à la télévision, et
aussi Eric Rohmer. Je ne me suis jamais senti seul depuis
que j'ai rencontré Alfie. Au début j'ai composé
d'après son journal intime, sans qu'elle le sache.
D'habitude j'écris d'abord la musique et j'ai du
mal à faire le contraire. Mike Mantler m'a appris
à trouver la musique dans les mots. Pour "Dondestan"
et "Shleep" Alfie avait des idées sur comment
adapter ses textes. La manière dont elle peint les
pochettes influence aussi ma façon de composer.
Alfie connaît bien la fragilité de son compagnon.
Elle a choisi d'habiter à Louth parce que Robert
peut se déplacer en toute indépendance : la
maison possède une rampe et tous les commerces sont
accessibles en fauteuil roulant. La collaboration avec le
label Ryko est agréable, comme les conditions d'enregistrement
que Phil Manzarena a offertes pour "Shleep". Aujourd'hui
Robert Wyatt est en pleine forme.
J. J. B. : Comment vois-tu l'avenir ?
R. W. : J'en suis incapable. Si j'improvise quelque chose
c'est bien ma vie. Souvent je me réveille et je ne
suis pas un musicien. Pendant des semaines je me plonge
dans des livres d'astronomie, ou bien je milite politiquement,
ou je m'insurge contre la malhonnêteté des
médias. Cela devient parfois un morceau mais le plus
souvent je suis trop énervé pour en faire
une chanson. Ce qui change sans cesse pour moi c'est le
passé. Il y a une infinité de façons
de le vivre. Ça bouge tout le temps. C'est pourquoi
il n'existe aucun endroit stable d'où je puisse regarder
l'avenir. L'Histoire est suspecte parce qu'il n'en subsiste
que la version écrite par les vainqueurs. Je ne voudrais
pas qu'on oublie les perdants. Par exemple je voudrais qu'on
se souvienne de l'extermination des Amérindiens ou
des luttes syndicales américaines dans les années
vingt. Le dernier champ de bataille se fait dans les livres
d'histoire.
En relisant ces lignes, Robert Wyatt ajoute : "J'ai
parlé de Roy Haynes alors que je joue du Joan Miro
!... Nous vivons et puis nous apprenons, dans cet ordre,
hélas!".
Traduction Jean-Jacques Birgé
Retranscription avec l'aide d'Agnès Desnos
| |
A ÉCOUTER " Rock Bottom " (Ryko
HNCD 1426/Harmonia Mundi). " Dondestan (Revisited)
" (Ryko HNCD 1436). " Flotsam Jetsam "
(Rough Trade 8399142). " Shleep ", Ryko
HNCD 1418). " EPS ", coffret de 5 CD, Ryko
HNCD 1440. " The different You - Robert Wyatt
e noi " Consorzio Produttori Independenti (Mercury
300496-2).
|
|
|